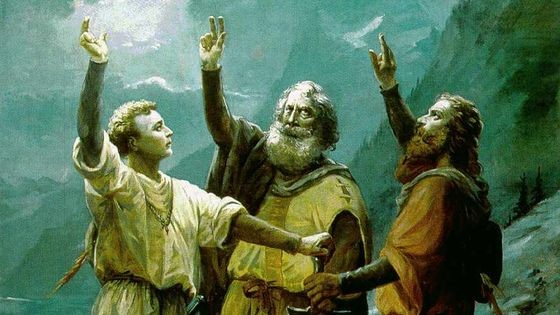
Le Serment de Rütli (1891), Jean Renggli
Chars amis svizzers, charas amias svizras,
A chaschun da quest emprim d’avust, vulain nus ans dumondar tge fablas che nus avain in Svizra. Cunzunt, tge linguas discurrin nus in Svizra, e tgeninas da quellas èn gist svizras ? E sch’ins chapescha gia fitg pauc il tudestg ed il talian en la Svizra romanda, tge savain nus dal rumantsch ? Questa lingua vegn tuttina considerada savens per ina vaira lingua svizra.1
Si le titre aura renseigné le lecteur sur la langue utilisée ci-dessus, la teneur de message restera probablement caligineuse. En effet, alors que le pluralisme linguistique confédéral est souvent cité par tout bon Suisse décrivant sa patrie à un étranger – forcément ignare –, il n’en reste pas moins que ce même Suisse, particulièrement s’il est Romand, ne parlera qu’un piètre italien qui lui suffira à mettre l’accento tonico là où les noms des pizze l’imposent. Il s’essaiera en outre au mieux au balbutiement de quelques mots d’allemand, souvenirs d’une dizaine d’années d’apprentissage souvent laborieuse, si sa sustentation lors d’un festival outre-Sarine l’exige. Malgré un manque d’aisance effectif dans les langues, un tel multiculturalisme helvétique, qui ferait pâlir d’envie Angela, François et les autres, est érigé régulièrement en fondement de notre belle patrie. Au même titre que notre héroïque résistance contre les baillis autrichiens, notre inflexible neutralité politique, notre président d’apparat, Guillaume Tell, Roger Federer et on en passe, le quadrilinguisme fédéral est en grande partie une image de la Suisse que l’on aime bien donner, au risque de gonfler un peu les faits.
À ce sujet, il est intéressant de se pencher sur le cas du romanche, tenu comme l’exemple type d’une langue complètement intégrée dans le fonctionnement de la Confédération et faisant partie de notre patrimoine culturel national depuis la nuit des temps. Si tous les Suisses en connaissent l’existence, peu en savent la teneur. L’on s’imagine par exemple que, passées les frontières cantonales grisonnes, l’on entendra parler le romanche par tous les Grisons, immuables gardiens de montagnes contadines.
Toutefois, ces idées reçues ne sont pas tout à fait fondées. En effet, quelle n’est pas la surprise de constater que d’une part, l’on s’adresse à vous en allemand dans les Grisons2, et que d’autre part, le romanche n’est pas une langue officielle au même titre que l’allemand, le français et l’italien.
Le romanche a certes un statut de langue nationale, mais celui-ci signifie seulement que ladite langue est autochtone. Outre son qualificatif de « national », la langue romanche fut faite partiellement officielle en 19383 afin de pouvoir revendiquer une langue proprement suisse, en des temps où les nationalismes exacerbés s’apprêtaient à faire sombrer l’Europe dans la Seconde Guerre mondiale. Le romanche, dès son adoubement, est ainsi lié à une recherche de ce que constitue l’identité suisse. Son statut semi-officiel, adopté en 1996 seulement, impose à Berne de traduire les textes qui concernent particulièrement les romanchophones dans leur langue. En d’autres termes, l’énorme majorité de la paperasse fédérale n’est jamais traduite en romanche.
Par ailleurs, il sied de noter que l’appellation même de la langue est peu claire. En effet, « le romanche » n’existe tout simplement pas. Ce à quoi on fait communément référence par ce terme est un ensemble d’au moins cinq idiomes et une koinè. Cette koinè, ou langue-toit4, est une langue inventée qui se veut un mélange des différents idiomes, agrémenté d’une grammaire fixe. Elle se nomme « rumantsch grischun » – soit romanche grison – et a été inventée en 19825 par le linguiste alémanique Heinrich Schmid. Elle est pour la première fois utilisée pour des textes officiels en 1986 et est officiellement adoptée comme langue de réponse des autorités grisonnes et subséquemment fédérales dix ans plus tard. C’est donc une langue qui a à peine plus de trente ans et qui a la particularité de n’être parlée… par presque personne.
Étant essentiellement une standardisation des cinq idiomes les plus parlés dans les régions romanchophones, il n’existe quasiment aucun locuteur de cette langue. On lui réserve les écrits officiels et les bulletins d’information de la Radiotelevisiun Svizra Rumantscha (RTR). Le reste des programmes de la radio et de la télévision publiques se font dans les idiomes, les dialectes. Ces derniers sont divisés en deux grandes familles, les patois de la vallée du Rhin – le sursilvan, le sutsilvan, et le surmiran – et ceux d’Engadine – le vallader et le puter. Seules ces langues sont effectivement parlées dans les patelins grisons et, plus largement, suisses. Car si 60’000 personnes parlent une de ces formes de romanche en Suisse, et donc dans le monde6, seuls deux tiers des locuteurs résident dans les Grisons. Quelque 20’000 romanchophones forment ainsi une diaspora fédérale et font diminuer le contingent des romanchophones grisons à quelque 40’000 personnes.
Il y a donc presque autant de locuteurs de l’anglais dans le canton de Genève et il y a nettement plus de lusophones qui habitent le pays de Vaud que de romanchophones dans les Grisons. Par ailleurs, il y a deux fois plus de chômeurs7 que de romanchophones, lesquels ne représentent finalement que 0,5% de la population8.
De surcroît, les romanchophones sont divisés, on l’a vu, en cinq idiomes, ce qui diminue d’autant leur poids politique. Il y a par exemple plus de Carougeois ou de fans de Darius Rochebin sur Facebook que de locuteurs du plus important des dialectes, le sursilvan, parlé par quelque 19’000 personnes. Le sutsilvan, le plus petit des patois, est parlé par moins de 1000 personnes, lesquelles pourraient aisément rentrer dans deux trains Intercity9.
Le romanche, bien qu’hissé au rang de langue partiellement officielle à l’orée de la Seconde Guerre mondiale, n’est ainsi pas une langue homogène mais au moins cinq idiomes et une koinè. Cette dernière, considérée aujourd’hui comme le romanche officiel10, a été inventée il y a 32 ans seulement et ne comprend pratiquement aucun locuteur. Il appert en conséquence que l’érection du quadrilinguisme confédéral en mythe fondateur de la Suisse repose largement sur des idées reçues qui n’ont finalement que peu de bases dans la réalité. Mais ne nous méprenons pas ; le romanche est une belle langue, et toute personne qui s’y intéresse devrait suivre les cours proposés par l’Université de Genève11, seuls cours publics de rumantsch grischun en français de Suisse12. Les romanchophones ont de surcroît autant le droit d’être reconnus par la Confédération que les Romands, les Alémaniques et les Tessinois. Enfin, malgré qu’il soit quelque peu gonflé, le quadrilinguisme est un beau mythe suisse et se bercer d’idéaux en romanche est mille fois préférable à tant d’autres mythes nationalistes aux accents parfois guerriers.
Bun emprim d’avust!
1 Chers amis suisses, chères amies suisses, en ce 1er Août, nous pouvons nous demander quels mythes nous avons en Suisse. Particulièrement, quelles langues parlons-nous en Suisse, et lesquelles sont vraiment suisses. Et si l’on sait l’allemand et l’italien déjà bien peu en Suisse romande, que penser du romanche ? Cette langue est pourtant souvent considérée comme une vraie langue suisse.
2 Tous les romanchophones parlent en effet couramment l’allemand
3 http://www.bk.admin.ch/themen/lang/04919/04998/index.html?lang=fr
4 De l’allemand Dachsprache, soit une langue que plusieurs peuples parlant différents dialectes utilisent pour communiquer entre eux.
5 Avant l’invention du rumantsch grischun, la Confédération utilisait à tour de rôle les différents idiomes.
6 A quelques exceptions près, au Japon notamment, comme en témoigne ce merveilleux twitterbot: https://twitter.com/rumantschjp
7 http://www.seco.admin.ch/themen/00374/00384/?lang=fr
8 http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/01/05/blank/key/sprachen.html
9 Tous les chiffres sont tirés de la Lia rumantscha, la faîtière des romanchophones
10 Les romanchophones peuvent s’adresser à Coire ou à Berne dans leurs idiomes respectifs, mais la réponse sera nécessairement en rumantsch grischun
11 http://www.unige.ch/lettres/roman/rhetoromanche/index.html
12 Des cours en allemand sont également disponibles aux universités de Fribourg (http://lettres.unifr.ch/de/sprachen-literaturen/mehrsprachigkeitsforschung-und-fremdsprachendidaktik/reto.html ) et de Zurich (http://www.rose.uzh.ch/studium/faecher/rum.html)


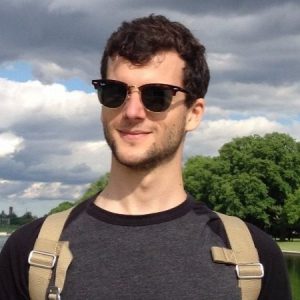

Merci pour cet article. Il est toujours appréciable de lire des contenus critiques de qualité. Pour la petite anecdote, une…