
Les lieux d’accueil bas seuil ont pour mission de répondre aux besoins fondamentaux de l’être humain comme dormir, se nourrir ou se laver. Parviennent-ils pour autant à préserver la dignité des personnes qui y recourent ? Faut-il repenser nos structures d’urgence ? Dans le cadre de leur mémoire réalisé à la HETS, Julie Frossard et Sara Karlen ont rencontré des personnes bénéficiaires de ces structures. Voici leur témoignage.
Retrouvez les autres contributions de notre dossier thématique consacré à la précarité ici.
Julie Frossard, Sara Karlen, vous avez étudié, dans le cadre de votre mémoire à la Haute école de travail social de Genève (HETS), l’utilisation des lieux d’accueil « bas seuil » à Genève. Pouvez-vous nous expliquer en quoi ceux-ci consistent précisément ?
Julie Frossard, Sara Karlen : Ce sont des lieux d’accueil qui proposent des prestations de première nécessité aux personnes touchées par la précarité. Ils font office de rempart contre les maux que traverse notre société aujourd’hui : pauvreté, isolement, solitude, stigmatisation et exclusion… autant de phénomènes qui se conjuguent à travers des conjonctures socio-économiques toujours plus sévères et compétitives. Dans ce contexte, un nombre croissant d’individus n’ont pas la possibilité de pourvoir à une partie ou à l’intégralité de leurs besoins fondamentaux (alimentation, hygiène, hébergement, mise à l’abri de la rue, accès aux soin, lien social) et sont contraints de recourir à l’aide de ces structures d’urgence.

La prise en charge dite « bas seuil » est d’abord apparue dans le domaine de la toxicomanie en Suisse dans les années 1980, avant d’être transposée de façon plus générale au champ de la précarité. Quel est le concept de cette prise en charge ?
JF, SK : Dans les années 1980, Zurich était effectivement surnommée la « capitale européenne de la drogue » : elle vit défiler pendant plus d’une dizaine d’années jusqu’à 3000 toxicomanes par jour, non loin de son centre-ville, d’abord au parc de Platzspitz puis dans la gare désaffectée du Letten. Si la problématique était tout d’abord cachée, les images de la scène ouverte firent rapidement le tour du monde et choquèrent l’opinion publique. La politique répressive en matière de drogue dut évoluer et intégrer d’autres dimensions importantes comme la prévention, la thérapie et la réduction des risques. Dans cette optique, le Conseil d’État genevois établit au début des années 1990 des seuils différents dans la prise en charge de la toxicomanie, dont le « bas seuil », c’est-à-dire une prise en charge individuelle médicale ou sociale de base, sans visée d’abstinence, proposant écoute, contact social, conseils et prévention1.
Aujourd’hui, dans le champ de la précarité et du travail social, cette prise en charge correspond à des lieux qui, dans l’urgence, répondent aux besoins primaires de l’être humain. L’accès se veut libre et anonyme, exempt d’entraves administratives ou de critères restrictifs. En plus des prestations matérielles, le but de ces structures est de représenter, grâce à la présence familière de professionnels reconnus comme tels et la régularité de l’accueil, un certain ancrage pour les personnes ayant perdu tout repère. Socialisation, sentiment de sécurité et de reconnaissance y sont donc essentiels : au-delà des besoins fondamentaux, le but est également de recréer du lien social et de rompre avec la solitude des journées à la rue.
Dans le cadre de votre recherche, la notion de dignité humaine a été centrale. Vous vous êtes demandé dans quelle mesure il était possible pour un individu de préserver sa dignité dans ce genre de lieu d’accueil. Pouvez-vous nous dire, en quelques mots, en quoi consiste cette dignité ?
JF, SK : La dignité humaine a fait l’objet de multiples interprétations d’ordre philosophique, éthique, religieux, juridique ou moral au cours de l’histoire : c’est un concept pluriel et sans cesse redéfini. Dans le droit international, la dignité est présentée comme une valeur inviolable et intrinsèque à toute vie humaine. La Constitution suisse, elle, garantit que « quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine »2. Aujourd’hui, c’est un concept largement invoqué dans les grands débats de notre temps (par exemple sur la fin de vie, les soins médicaux, l’avortement ou la migration), parfois aussi instrumentalisé. Nous avons donc voulu questionner directement les personnes qui bénéficient des lieux d’accueil d’urgence. En tant qu’utilisatrices, ce sont elles qui sont expertes de ces structures : seules elles peuvent dire comment elles vivent dans cette situation, et comment elles s’y sentent.
Toutes les personnes que vous avez interrogées dans votre recherche ont fréquenté ou fréquentent encore les lieux d’accueil bas seuil à Genève. Elles ont aussi en commun d’avoir dû vivre ou de vivre encore dans la rue. Présentaient-elles d’autres similitudes ?
JF, SK : Leurs trajectoires de vie sont forcément singulières, mais elles avaient toutes connu une rupture avec leur environnement social et professionnel, ainsi qu’une rupture relationnelle qui les a précipitées à la rue du jour au lendemain. L’absence d’emploi engendre ensuite un statut de marginalité dont il très dur de s’extirper, en raison de l’importance culturelle accordée au travail en Suisse.
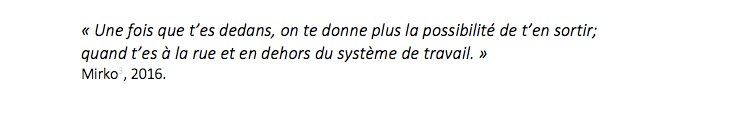
Ces personnes-là ont-elles du mal à faire la démarche de recourir à ces prestations ?
JF, SK : Oui, beaucoup. La majorité de nos interlocuteurs nous a confié s’être rendue en premier lieu dans ce type de structure par nécessité et donc, par obligation : elles avaient besoin d’un repas, d’une douche ou d’un temps de pause, à l’abri du froid et de la rue. Une minorité seulement s’y est rendue dans une volonté de distraction et de passe-temps.
Enfin, quand on leur a demandé frontalement, en fin d’entretien, s’ils se sentaient dignes ou non, tous relèvent la dimension de la fierté… qu’ils ont dû mettre de côté pour venir bénéficier des structures d’urgence.
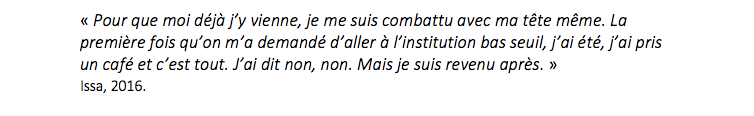
Vous les avez interrogées sur leur fréquentation des lieux d’accueil et les sentiments qu’elles en retiraient, sans parler frontalement du concept de dignité, afin qu’elles en esquissent librement leur propre définition. Quels sont, tout d’abord, les sentiments positifs qui ressortaient de leur recours passé ou actuel à ces structures ?
JF, SK : Nous avons pu constater que, globalement, et en particulier en ce qui concerne les lieux d’accueil de jour, les gens s’y sentent assez bien. Ils relatent tous un sentiment très positif d’être et d’exister dans ces lieux, reconnus par l’autre, qu’il s’agisse d’autres usagers ou des travailleurs sociaux. Les moments des repas sont ressentis par tous comme un moment convivial, de partage, qui leur procure un sentiment de bien-être. La socialisation qu’ils y trouvent est fondamentale, que ce soit par le biais de discussions ou d’activités organisées dans les lieux. L’accueil bienveillant qu’ils y reçoivent joue une fonction de sécurisation et de stabilisation très importante. Pour les usagers, le lien social occupe ainsi une place tout aussi importante, si ce n’est plus, que les prestations d’ordre matériel.
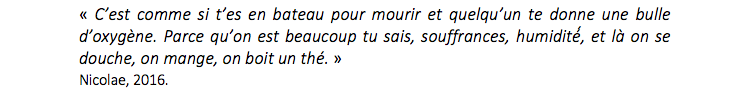
Or même si ces lieux leur procurent du lien social, celui-ci relève malgré tout d’une socialisation alternative : c’est-à-dire qu’il leur est difficile de bénéficier de cette socialisation ailleurs dans la ville et dans leur vie, en raison de leur statut.
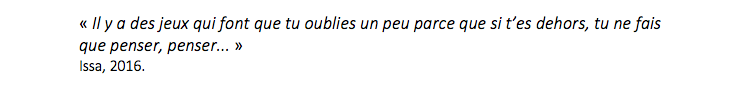
Quels étaient pour eux les vecteurs d’indignité, d’inconfort ou de mal-être dans ces lieux ?
JF, SK : Toutes les personnes que nous avons rencontrées nous ont confié leur appréhension négative à l’égard des abris d’hébergement nocturne. La peur de se faire voler ses affaires, la surpopulation des lieux et les tensions qu’elle génère entre les usagers font qu’ils préfèrent dormir seuls dans la rue ou dans la nature.
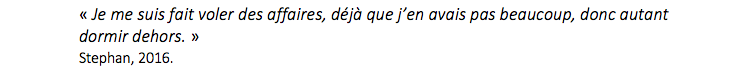
En effet, s’endormir requiert le plus grand lâcher-prise qui soit : il faut se sentir pleinement en sécurité pour pouvoir s’abandonner au sommeil. De plus, la dimension instable des accueils nocturnes (limités dans le temps et dans le nombre de nuitées) ne couvre pas le besoin de stabilité des usagers. Ce sentiment d’insécurité contraste fortement avec celui ressenti à l’égard des lieux d’accueil diurnes.
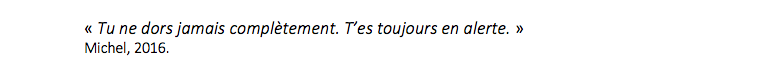
La fréquentation croissante des lieux constitue également un vecteur d’indignité pour les usagers. Le fait de devoir faire la queue, de s’inscrire à l’avance, de prendre un ticket, d’attendre longuement pour bénéficier de prestations matérielles, par exemple, les fait parler de « bétail humain » : on assiste à une perte de la singularité, à une non-reconnaissance de son existence par autrui. D’autant plus qu’ils n’ont pas la garantie de bénéficier de ces prestations, en raison du surplus de monde et des impératifs procéduriers des structures. Ils font parfois la queue durant longtemps pour rien. C’est une chose qu’on ne peut pas se représenter quand on n’est pas dans cette situation : quand nous allons boire un café, manger au bistrot à midi, nous pouvons nous asseoir à table librement et commander à manger. Cette dégradation de la qualité d’accueil des structures bas seuil genevoises est également observée par les acteurs du terrain, qui relèvent une forte augmentation de la précarité à Genève4, confirmant que les circonstances socio-économiques compromettent la dimension essentielle du lien social dans ces lieux.
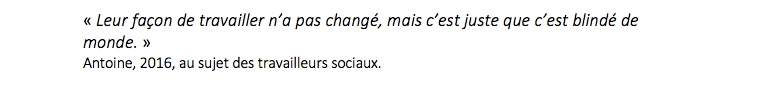
Vous relevez également que le rapport au corps est déterminant dans – et en dehors de ces lieux – pour les personnes en situation de précarité. Qu’ont-elles confié à ce sujet ?
JF, SK : Tout ce qui touche au corps relève de la sphère intime, et joue donc un très grand rôle. Ne pas se sentir propre, devoir se laver dans les toilettes publiques, ne pas pouvoir pourvoir librement à son hygiène personnelle, ne pas pouvoir accéder aux soins médicaux… c’est un grand facteur d’indignité. A tel point que toutes les personnes que nous avons interrogées ont révélé accorder une vigilance accrue à leur corps, de manière à anticiper les risques liés à l’insalubrité et aux maladies. Elles disposent toutes de stratégies très développées pour pouvoir se laver, dans le cas où elles ne peuvent recourir aux douches, mais aussi pour garder une bonne hygiène de vie.

La philosophe Tanella Boni, dans son étude de la dignité, écrit très justement que le corps est le premier lieu d’existence et que « la dignité humaine est d’abord celle du corps, vivant ou mort »5 : les témoignages de ces personnes confirment à quel point le corps constitue à la fois le premier et dernier bastion de leur existence. L’énergie qu’ils lui dévouent fait rempart contre le processus de déshumanisation auquel ils sont confrontés.
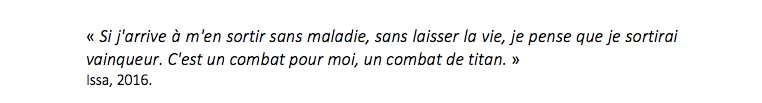
Au terme de votre travail de recherche et au vu des informations que vous avez récoltées, quelle est la conclusion la plus importante que vous tirez, en tant que professionnelle(s) du travail social ?
JF, SK : Malgré les aspects positifs dont nous avons parlé, le plus grand regret des personnes que nous avons interrogées est d’être toujours confinées dans ces lieux. Elles ne se mélangent pas à la population genevoise, elles ont l’impression de ne pas exister dans Genève mais seulement dans ces lieux. Elles nous ont par exemple parlé d’un lieu d’accueil qui s’était érigé en plein air, en été, dans un parc public genevois. Là, elles pouvaient participer à des activités sportives ouvertes à tous ; les passants alentours se joignaient à eux naturellement. Ce cadre d’accueil, implanté dans la vie quotidienne d’un quartier, a énormément marqué les usagers : il était alors moins question d’exclusion.
Les lieux d’accueil qui existent aujourd’hui sont indispensables et répondent à l’urgence de la situation, mais ne la résolvent pas : ces personnes restent invisibles, en marge de la société. Ils sont maintenus à la limite de la survie et ne parviennent pas à stabiliser leurs conditions de vie. En dehors des professionnels du travail social et des soins, personne n’a accès à ces individus. Entre eux et la société civile, il n’y a presque pas de ponts, à part ces travailleurs sociaux, qui peuvent s’engager à porter leur parole plus loin. Dans ce contexte, le rôle des journalistes est indispensable : il informe le grand public sur les réalités observées sur le terrain.
Pouvez-vous donc identifier quel genre de lieu serait optimal pour les personnes contraintes d’y recourir ? Faudrait-il démultiplier les lieux d’accueil ?
JF, SK : La vraie question qui se pose est celle-ci : comment amener la question de l’exclusion au cœur des débats ? L’enjeu est de taille : il s’agit d’amener cette problématique dans l’espace public, de manière à solliciter et responsabiliser les citoyens vis-à-vis de leurs semblables humains. La société étant la première productrice de marginalité, il est de notre devoir de contrer les normes qu’elle ne cesse de véhiculer et contrôler, afin d’y inclure la palette riche et variée des possibilités d’être et d’exister dans le monde.
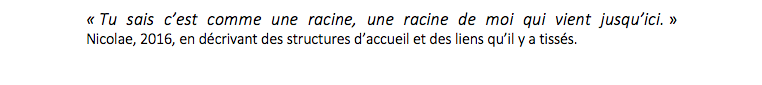
Dans tous les cas, il apparaît indispensable de penser nos lieux d’accueil différemment : des endroits où les gens peuvent se mélanger, peu importe s’ils sont affiliés à la même norme sociale ; des lieux où une personne précaire peut boire son café à côté d’une personne active, sans distinction aucune. C’est le cas par exemple à La Galerie à Genève6. L’initiative des cafés suspendus7 va aussi dans ce sens-là : elle donne la possibilité aux personnes démunies d’exister en dehors de lieux reclus. Enfin, rappelons que les squats jouaient ce rôle-là : ils constituaient une solution d’hébergement efficace pour les personnes en précarité de logement pour quelque raison que ce soit. Ces lieux alternatifs garantissaient précisément la mixité au sein de la cité de Calvin, qui était une véritable capitale du squat dans les années 1990 !8 La fermeture progressive des squats a contribué à décupler l’isolement et la marginalité de ces personnes.
Il s’agit également de rappeler que l’accueil bas seuil n’est que rempart et non pas aboutissement. Il semble urgent de décharger le poids procédurier qui pèse sur l’accueil bas seuil, de revendiquer ses limites afin de préserver la dignité de ses usagers à travers le lien social. Il ne s’agit donc pas tant de les démultiplier que de prôner le développement d’initiatives créatives et inclusives en faveur d’êtres humains en proie au tumulte sans fin de notre environnement sociétal.
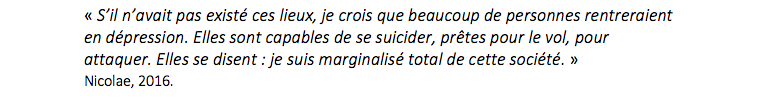
1. http://ge.ch/grandconseil/memorial/seances/530206/21/8/
2. https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19995395/index.html
3. Tous les prénoms mentionnés sont des prénoms d’emprunt.
4. La venue de nombreux ressortissants du sud de l’Europe en quête d’un emploi, l’arrivée considérable de migrants cherchant à fuir leur pays d’origine, l’insécurité liée à un marché du travail toujours plus inaccessible ainsi que l’augmentation du taux de chômage sont autant de facteurs susceptibles d’expliquer les changements perceptibles au sein des structures d’accueil bas seuil (Budry, 2016).
5. Boni, Tanella (2006). La dignité de la personne humaine : de l’intégrité du corps et de la lutte pour la reconnaissance. Presses universitaire de France « Diogène », 215, 65-76.
6. Bar et lieu d’accueil qui propose des repas, des soirées et des concerts ouverts à tous et bon marché. http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/social/galerie/
7. Principe selon lequel on paie, dans un lieu de restauration, une consommation d’avance pour une personne plus démunie que soi. Plusieurs bistrots genevois proposent cette pratique simple et sociale. https://www.tdg.ch/vivre/gastronomie/Le-cafe-suspendu-un-petit-noir-a-l-arome-de-solidarite/story/25645871
8. Au milieu des années 1990, Genève comptait près de 160 lieux occupés par 2000 personnes. https://www.swissinfo.ch/fre/que-reste-t-il-des-squats-genevois-/6011766 et https://www.rts.ch/archives/tv/culture/viva/3474276-la-culture-squat.html.
Le mémoire dont il est question dans cet entretien s’intitule « Structures d’accueil bas seuil : rempart contre l’indignité humaine ? », effectué dans le cadre de la formation à la Haute école de travail social de Genève, par Julie FROSSARD, Sara KARLEN et Clément LANDRY, en 2017.





Laisser un commentaire
Soyez le premier à laisser un commentaire