
Frédéric Esposito, chercheur et enseignant de l’Institut d’études globales. [UNIGE]
La nouvelle a fait l’effet d’une bombe politique tôt vendredi matin: les citoyens du Royaume-Uni ont décidé dans les urnes de quitter l’Union européenne. L’issue de ce vote soulève depuis lors d’innombrables questions sur l’avenir de l‘Europe et de ses peuples. Pour y voir plus clair, nous sommes allés à la rencontre de Frédéric Esposito, professeur au Global Studies Institute et grand spécialiste de la gouvernance européenne. Au menu de cet Entretien Jet d’Encre spécial Brexit: enjeux démocratiques autour du référendum britannique, déficit de légitimité de l’UE auprès de ses peuples, European bashing, cohésion de l’Union, conséquences pour la Suisse et balkanisation du Vieux Continent.
À l’Université de Genève, vous enseignez un cours intitulé Légitimité et démocratie participative en Europe, dans le cadre duquel vous posez la question de comment étudier le caractère démocratique de l’Union européenne alors que les outils d’analyse de la démocratie sont traditionnellement centrés autour de l’État. Le Brexit constitue en ce sens un cas d’étude intéressant. Pour les Britanniques, ce vote a été démocratique, peu de doute là-dessus. Toutefois, si le niveau d’analyse est déplacé à l’échelon européen, et si nous considérons les implications potentiellement majeures que ce vote revêt pour l’avenir de l’Union dans son ensemble, nous serions alors peut-être en droit d’interroger l’esprit démocratique de ce référendum. Qu’en pensez-vous? Quel est l’espace politique dans lequel ce type de question devrait être posé? Les autres peuples de l’Union devraient-ils être consultés dans de telles circonstances?
Frédéric Esposito: C’est une question à plusieurs tiroirs. Je vais les prendre l’un après l’autre, si vous le permettez. La première question porte sur le caractère du déficit démocratique dans l’Union européenne (UE). Je pense qu’il est bien de rappeler que la démocratie moderne est née dans les États, fondée sur l’existence d’un peuple, le fameux “demos”, avec une représentation politique suivant laquelle on accepte l’idée que des gens nous représentent dans les parlements. Cette réalité théorique a posé durant de nombreuses années de grandes difficultés aux chercheurs en sciences sociales, parce que la question posée était comment penser la démocratie en dehors de l’État. Et toutes les réformes institutionnelles qui ont été mises en place par l’Union dans le débat politique au cours de ces vingt dernières années ont toujours singé la démocratie libérale sur le plan national, à savoir un fonctionnement de type parlementaire, avec une ou deux chambres, un contrôle des chambres sur le gouvernement, des élections, etc.
En partie, l’UE répond à ces exigences, mais en partie seulement. Puisque comme vous le savez, il y a une chambre, qui est celle des députés, mais le co-législateur européen est représenté par les ministres. On a donc un système très étonnant où un exécutif est en même temps un co-législateur. On voit bien qu’on n’est déjà plus dans le modèle “classique”. De plus, les élections ont lieu tous les cinq ans, mais le débat est très orienté sur les préoccupations nationales (bien que cela ait tendance à s’améliorer). Il y a une vraie difficulté à faire une place aux questions européennes dans les débats au niveau des États membres.
Ainsi, fort de ce constat, certains se sont dit – et il s’agit là d’un courant minoritaire – qu’il n’y a au fond pas de déficit démocratique, car les attentes en termes de démocratie que nous avons vis-à-vis de l’UE sont exagérées. Selon eux, il n’y aurait pas de déficit parce que l’UE ne peut simplement pas répondre aux critères d’un régime démocratique, dans la mesure où la démocratie aujourd’hui, et c’est une approche plutôt libérale anglo-saxonne, repose essentiellement sur le rôle des parlements nationaux. Le berceau de la démocratie moderne réside dans les parlements nationaux et, par conséquent, c’est leur renforcement, plutôt qu’un renforcement des pouvoirs au niveau de l’UE, qu’il faudrait réaliser. Il n’y aurait donc pas lieu de parler de déficit démocratique au niveau de l’Union en tant que telle.
Il y en a d’autres au contraire qui estiment que ce dont souffre l’UE, c’est de l’absence à la fois de compétition électorale, d’un meilleur contrôle sur les élites européennes et d’outils pour renforcer la participation citoyenne. Or, ce débat-là est tout aussi stérile, car il n’y a pas de culture politique homogène: si les Français veulent un système peut-être semi-présidentiel, sachant qu’ils ne veulent surtout pas faire d’ombre à leur propre président, les Allemands, de leur côté, aimeraient renforcer le fédéralisme dans l’UE, tout en n’affaiblissant pas leur position. Il y a donc aussi un rapport très schizophrénique, une volonté à la fois de développer la démocratie au niveau européen et de la faire cohabiter avec l’espace national.
Dans cette configuration, la solution qui a été trouvée depuis le milieu des années nonante est de changer de “logiciel” et de parler de gouvernance. On peut en effet penser la démocratie dans l’espace post-national en déplaçant le cadre, en contournant l’obstacle, en disant qu’il ne s’agit pas de créer un super-État mais plutôt d’améliorer la gouvernance dans l’UE. En d’autres termes, on peut parler du mode de fonctionnement de l’UE sans passer par la case État supra-national, suivant laquelle tant qu’il n’y a pas un gouvernement comparable à ce qu’on retrouve dans les États membres, tant qu’il n’y a pas de “demos”, il est impossible de penser la démocratie. On peut le faire, mais avec une perspective différente parce que la réalité européenne est différente. Cela ne veut pas dire que le modèle “classique” est disqualifié – je pense que le terme démocratique est tout à fait pertinent – mais il faut employer un autre outil, un autre “logiciel” et c’est celui de gouvernance.
Dans ce contexte, l’enjeu sur le référendum britannique constitue une parfaite illustration. On a en effet un vote souverain d’un État membre dont les conséquences touchent l’ensemble de l’espace public européen. L’enjeu de ce scrutin, comme tous les votes européens pour lesquels l’UE n’a aucune solution, c’est de concilier la logique nationale avec la logique communautaire. À mon sens, le paradoxe de ces votes référendaires est que l’UE a été construite dans la logique de l’unanimité. En d’autres termes, chaque nouvelle étape doit faire l’objet d’un accord de tous les États membres sans exception. Ainsi, chaque fois qu’on a eu une opposition, soit on a refait voter, c’est le cas des Danois sur le Traité de Maastricht ou des Irlandais sur le Traité de Lisbonne, soit on abandonne le projet, type Constitution européenne, refusée par les Hollandais et les Français. Dans le cas de la Constitution européenne, les Pays-Bas et la France étant des États fondateurs de l’Union, leur poids a été jugé plus important que celui des Danois ou des Irlandais, si bien que la procédure a été arrêtée. D’ailleurs, les suivants sur la liste, après les Français, devaient alors être les Britanniques… Ils n’ont finalement pas voté, et je pense que les éléments du vote de jeudi dernier remontent peut-être aussi à l’origine au vote sur la Constitution européenne, au sujet de laquelle les Britanniques n’ont pas été consultés.
Il y a donc une tension entre d’un côté cette logique dite de l’unanimité à l’échelon de l’Union et de l’autre la logique des référendums qui est majoritaire à l’intérieur des États. Les deux espaces sont complètement interdépendants aujourd’hui. Mais on n’a pas de solution institutionnelle, uniquement des solutions politiques. Et ces solutions politiques s’épuisent. Elles ont ceci de problématique qu’elles ne constituent pas un standard: pourquoi n’a-t-on pas fait la même chose pour les Irlandais au moment du Traité de Lisbonne que pour les Français et les Hollandais sur la Constitution? Ces deux logiques qui s’affrontent et s’entrechoquent au moment des référendums représentent une difficulté politique majeure.
Mais est-ce que cela doit disqualifier l’outil du référendum pour autant? On est en Suisse, et j’ai écrit sur le référendum européen, donc certainement pas pour moi! Une des vertus que l’on a oubliée dans ce vote, c’est que le référendum est un formidable promoteur du débat public. Les étudiants étrangers tombent de leur chaise lorsque je leur dis que sur le site de l’administration publique suisse, les votes sont aujourd’hui organisés jusqu’au 22 février 2035. J’ai été vérifier [rires]. On a une votation qui est déjà prévue. Sur quel objet? On n’en sait rien. Mais cela veut dire que l’appareil gouvernemental et administratif prend rendez-vous quatre fois par an avec ses citoyens sur les sujets qui arriveront sur la table à un moment donné, que ce soit par les référendums ou les initiatives. Il y a ainsi une permanence et une qualité dans la démocratie suisse et aussi, plus généralement, une vraie qualité dans la logique référendaire, pour autant qu’on la respecte… Bien qu’on voit souvent l’aspect négatif du référendum, son côté plébiscitaire comme c’est le cas en France ou en Angleterre, l’emprise des lobbies, etc., la consultation des peuples européens me paraît aujourd’hui essentielle. La question est de savoir comment on peut l’organiser dans un espace à 28 – peut-être 27 – États.
Depuis Maastricht, les consultations citoyennes prennent de l’importance au niveau européen. Maastricht a été en ce sens une sorte de révélateur. Dominique Wolton, qui aime bien les formules, parlait ainsi de “la naissance démocratique de l’Union européenne”, parce que pour la toute première fois, le soutien intangible des peuples européens n’était plus acquis. Il faut quand même se rappeler que toute la construction européenne s’est faite sur le postulat selon lequel les peuples européens soutiennent le projet. Or, avec Maastricht, tout d’un coup, on voit les fissures. Il y a le non initial des Danois. En France, ça passe tout juste, le débat est très intense. Ce qui ressort de cet épisode, c’est qu’il n’y a pas une opposition fondamentale au projet européen, mais il y a un débat critique qui se met en place. Le problème est qu’on n’a jamais donné la place à ce débat critique de s’exprimer au sein de l’Union, ce qui ne manque pas de faire le jeu des mouvements nationalistes. Je trouve dramatique qu’il ait fallu attendre un référendum au Royaume-Uni pour que ce débat critique se réveille d’une certaine façon.
Historiquement, Maastricht a été un véritable détonateur. Soudainement, on a considéré la nécessité d’aller vers les citoyens comme étant prioritaire. Jusqu’à alors, la Commission européenne ou le Conseil européen ne jugeaient pas fondamental de se rapprocher des citoyens, malgré les discours ou l’enrobage de certaines politiques. Après Maastricht, un changement complet de perspective s’est opéré. Il faut désormais aller près des citoyens et donc tenir aussi compte des référendums. D’ailleurs aujourd’hui, à chaque fois qu’il y a un nouveau traité qui est signé, la première question qu’on se pose est : qui va voter? C’est devenu un élément qui n’est plus du tout périphérique dans le débat. Et les élites politiques craignent cette consultation, alors que cela devrait être tout le contraire. Sur ce point, l’Union européenne devrait prendre le contre-pied.
Elle l’a fait en partie avec l’initiative citoyenne. Il s’agit d’une pétition collective, avec néanmoins un résultat très aléatoire, puisque l’issue dépend de l’analyse faite par la Commission européenne. C’est ainsi que les quatre initiatives qui ont abouti jusqu’ici ont toutes été rejetées, selon des arguments très techniques de la part de la Commission. Elle en a fait une lecture technique et pas du tout politique. C’est tout de même assez extraordinaire qu’on ait plus d’un million de gens, dans au minimum sept États, ce qui constitue un énorme travail en termes de récolte de signatures, et que l’aboutissement de la première initiative n’ait malgré tout guère marqué un motif de contentement particulier de la part de la Commission. Je regrette que ce nouveau canal de participation soit au final mal évalué par la Commission européenne.
Peut-on aller plus loin? J’avais réalisé un projet de consultation citoyenne pour le Parlement européen, en me basant notamment sur les recherches que j’avais conduites sur le référendum et les votes européens. Et il en ressort qu’il existe un substrat, c’est-à-dire que même s’il n’y a pas des cultures partagées, il y a aujourd’hui une volonté de la part des peuples européens d’être davantage consultés. Et on peut tout à fait imaginer que la Commission européenne puisse l’utiliser comme un objet de politique. Techniquement, organiser des consultations régulières sur les grandes orientations politiques est faisable grâce à la démocratie électronique. On tord ici le cou à une des conclusions d’un des livres du grand théoricien de la démocratie qu’est Robert Dahl. Il a écrit un ouvrage qui s’appelait Size and Democracy, et schématiquement sa conclusion était qu’à l’exception des États fédéralistes comme les États-Unis ou l’Inde, il n’est pas possible de penser la démocratie à des échelles disons de plus de cent millions de personnes. Il disqualifiait donc l’UE de toute velléité de vouloir représenter ou de ressembler à une démocratie représentative, voire même à un État fédéral puisqu’il n’y croyait pas. Que ce soit avec les smartphones, les bornes ou encore internet, il y a aujourd’hui une possibilité d’organiser la consultation. On peut ainsi balayer les contre-arguments sur les modalités techniques, mais il reste la sécurité d’un système.
L’autre question est de savoir ce qui unit les Danois aux Italiens, aux Espagnols, aux Portugais en termes de culture politique. Leurs pratiques politiques respectives sont bien sûr démocratiques, mais les cultures politiques diffèrent. Tout l’enjeu de ces votes populaires s’apparente précisément à ce qu’on observe en Suisse. La question de l’équilibre et de la mise en minorité est cardinale. C’est ce qui fait que lorsque les Romands, les Tessinois ou les Suisses allemands perdent une votation importante, ils ne demandent pas de sortir de la Suisse. Le pays tient. On reste suisse. Or, dans le cadre de l’espace public et politique européen, on n’en est pas encore là.
Imaginons une consultation citoyenne où vous avez l’Allemagne, la France et l’Italie qui sont mis en minorité par d’autres États. Une telle situation ferait un peu désordre, dans la mesure où comme on l’a vu avec le Traité constitutionnel, si les Français disent non par exemple, on arrête le processus, alors que si ce sont les Danois ou les Irlandais, on continue. C’était d’ailleurs là tout le sens d’une des sorties de Roland Dumas après le vote danois en 1992. La France était alors en pleine ratification du Traité et réfléchissait sur l’opportunité ou non d’organiser un référendum. La décision n’avait pas encore été prise par Mitterrand, et Roland Dumas avait eu cette phrase très condescendante à l’égard des Danois, suivant laquelle: “la loi française ne procède pas de Copenhague mais de Paris”. En gros, on n’en a rien à faire des Danois. On va leur dire comment voter, on va leur faire un traité avec de nouvelles disposotions et la chose est réglée.
Effectivement, s’il s’agit de grands enjeux, par exemple un revenu minimum demain, et que les grands États disent non alors que les moyens États ou les États du Sud disent oui, ce sera difficile de faire accepter aux grands cette décision. Car même si tous les États ont le même droit de vote, et qu’il y a une pondération pour les euro-députés, on sait que la construction européenne s’est faite grâce au couple franco-allemand. J’ai envie de dire avec un troisième larron qui est le Royaume-Uni, mais pour l’instant il est sorti. Il y a donc une prédominance dans le projet européen. D’ailleurs, c’est ce qu’on attend d’eux. La plupart des chefs d’État et de gouvernement se tournent maintenant vers l’Allemagne et la France pour demander qu’est-ce qu’on va faire?, sous-entendu qu’est-ce que vous allez faire?. Il y a un vrai enjeu politique. Est-ce qu’un Français ou un Allemand acceptera d’être mis en minorité par d’autres États membres? Il s’agit d’une des clés pour penser un espace public sur le plan européen, en dehors d’autres exigences comme celle d’avoir un média davantage présent.
Il est en effet vrai qu’à part ARTE et EuroNews, il n’y a pas de média qui puisse catalyser cet espace-là. Il y a eu des tentatives. The Europeans n’avait pas fonctionné. Prenons l’exemple des dernières élections européennes et l’élection à la Commission européenne. Pour la toute première fois, une simultanéité entre les deux élections a eu lieu, et on a pu assister à un vrai débat entre les candidats à la Commission européenne. Mais ce débat-là, pour le trouver sur une chaîne publique, il fallait se lever de bonne heure. En France, c’était sur des chaînes du câble, ou alors retransmis en différé à une heure tardive. Aucune chance de pouvoir le suivre correctement, bien qu’il y ait évidemment le web.
J’avais d’ailleurs moi-même été particulièrement frappé, car au moment des résultats en 2014, j’étais à Bruxelles. La ville était remplie de scènes et de gens pour un festival annuel de jazz bien connu. Devant le Parlement européen, une scène avait aussi été installée, non pas pour que des groupes s’y produisent, mais avec un écran géant où les résultats des élections européennes tombaient. Et là, il n’y avait personne, alors que partout ailleurs, c’était noir de monde. Ceci est révélateur d’un certain désintérêt. Il faut aussi s’interroger sur ce désintérêt à participer à un processus politique qui est unique au monde de par son caractère transnational.
En lien étroit avec les éléments de réponse que vous venez de proposer, notre prochaine question a trait à la légitimité de l’UE. France et Pays-Bas en 2005 (Constitution européenne), Irlande en 2008 (Traité de Lisbonne), Grèce en 2015 (mesures d’austérité de la “Troïka”), Royaume-Uni la semaine passée: les référendums touchant à la question européenne organisés au cours des dix dernières années dans nombre de pays de l’Union accouchent souvent d’un résultat désavouant Bruxelles. L’Europe souffre-t-elle en ce sens vraiment d’un déficit de légitimité auprès de ses peuples, comme les médias l’évoquent régulièrement? Et le cas échéant, pensez-vous avec le Professeur Levrat que ce manque de légitimé est dû à l’absence de renouvellement du projet d’intégration européenne sur le plan des idées?
F.E.: Commençons d’abord avec la question de la démocratie et de la légitimité. Aujourd’hui, en théorie politique, on en a fait des synonymes. Mais il n’y a pas de raison que ce soit le cas. On peut en effet avoir un gouvernement légitime mais qui n’est pas démocratique. Une monarchie peut ainsi disposer du soutien de ses sujets, sans être démocratique pour autant, en ce sens que le choix de ses dirigeants n’est pas le fait d’une procédure démocratique. Aujourd’hui, on a fait de la démocratie et de la légitimité deux termes équivalents, mais il convient de creuser davantage cette mise en équation. Dans le cas de l’UE, on parle d’un déséquilibre entre, d’une part, le transfert de souveraineté que les États donnent à Bruxelles et, d’autre part, la faible légitimation de ce transfert. Il s’agit d’une question à deux boîtes.
La première boîte est institutionnelle. C’est ce qu’on appelle la légitimité démocratique. Quelles sont les procédures qui permettent la mise en place des institutions et des leaders? Là on revient au débat sur la démocratie. Nos leaders européens sont choisis sur des bases démocratiques. Il y a des élections, des votations. Ces leaders désignent ensuite eux-mêmes certains membres des différents organes. C’est le cas de la Cour de justice par exemple, où les juges sont nommés. Il y a donc une légitimité démocratique directe ou indirecte dans l’UE, laquelle n’est ni moins bien ni meilleure que ce qu’on observe dans les espaces publics nationaux.
En revanche, là où il y a un véritable débat, et c’est l’autre pan de la légitimité, c’est pour ce qu’on appelle la légitimité sociale ou politique. Il s’agit ici du soutien que nous conférons à un système. Et dans ce cas, on est sur une base qui est totalement subjective. Qu’est-ce qui fait que vous allez donner votre soutien à un homme ou une femme politique? Est-ce qu’il est corrompu ou pas? Est-ce qu’il a tenu les engagements auxquels il faisait face? Est-ce qu’il est capable de résoudre la crise économique? Etc. Ce sont tous des indicateurs qui, passés au tamis de chaque individu, vont donner des réponses très diverses.
C’est s’agissant de cette légitimité sociale ou politique qu’on observe un décalage, par exemple au sein des euro-baromètres (sondages d’opinion qui sont faits depuis maintenant trente ans), où on voit un fort soutien au projet européen, mais en même temps, les Européens sont très critiques sur certains des objectifs. Il y a ainsi une défiance à l’encontre du personnel politique, mais surtout – et c’est le point que soulevaient Nicolas Levrat ou d’autres – un certain désenchantement en l’absence d’un grand projet depuis la Constitution européenne. La prospérité économique, les droits humains, c’est une chose. Ce sont des thèmes toujours d’actualité, mais il y a des nouveaux enjeux qui devraient être sur la table, dont notamment la question des droits économiques et sociaux.
Regardez ce qu’il se passe en Grèce par exemple. Vous ne pouvez pas laisser un peuple en souffrance et lui dire simplement de respecter le plan d’austérité, les plans que le FMI ou la Commission ont élaborés. Ce n’est plus acceptable. De la même façon, il y a un enjeu sur les questions migratoires. L’article 2 de l’UE nous dit que l’Union doit respecter la démocratie et les droits humains, entre autres. Mais dans quelles conditions est-ce qu’on accueille les migrants aujourd’hui? Ce n’est tout simplement pas en adéquation avec les valeurs essentielles de l’Union. Or, il n’y a rien de tout cela sur la table actuellement.
Par ailleurs, il y a un décalage entre les compétences que les États ont transférées à l’Union et les compétences qu’ils n’ont pas transférées et pour lesquelles aujourd’hui il y a des demandes très fortes des citoyens. Les fonctionnaires à Bruxelles rêveraient de s’occuper de ces questions ayant trait aux droits économiques et sociaux, mais l’UE n’a aucune maîtrise là-dessus.
Sur les questions migratoires par exemple, l’Europe est dans un discours très difficile à tenir. Elle voit la Grèce ou l’Italie, à Lesbos ou à Lampedusa, qui essaient de faire comme elles peuvent. L’UE peut certes mettre de l’argent à disposition. Il y a en outre maintenant des unités mixtes pour surveiller les côtes méditerranéennes. On mutualise aussi l’infrastructure militaire. Mais au final, il y a tout de même des gens qui meurent dans la Méditerranée, sans qu’il n’y ait de réponse politique globale qui soit apportée. De manière fort révélatrice, nous sommes uniquement parvenus à nous accorder sur des quotas. Face à une détresse humanitaire, on répond en termes de quotas. Ceci montre bien le décalage qui existe entre les enjeux tels qu’ils sont posés et la réponse institutionnelle de l’UE qui est faite avec des bouts de chandelle, car elle n’a au fond pas d’autres outils que ceux-là.
De leur côté, les États jouent aux pompiers pyromanes sur les questions européennes. On est très heureux de filer à Bruxelles, mais en même temps, on va être extrêmement critique une fois qu’on rentre dans son espace public national. Ceci fait énormément de mal. Le Brexit est la résultante de plus de trente ans d’European bashing de la part des États européens. À un moment donné, ça se paie. Et là, je pense que le résultat britannique est un bon révélateur de cet écart en termes d’opinion publique, de soutien, de légitimité sociale et politique, qu’il va falloir rattraper.
Maintenant, comment on rattrape? Je suis quelqu’un d’optimiste par nature. Il y a désormais un énorme chantier qui s’ouvre devant les dirigeants européens. Ils ne devront pas le rater. En ce sens, j’ai été attéré de la réponse très froide de Junker au vote britannique, dans laquelle on sentait déjà le vent du boulet caresser le visage des Britanniques. On sent qu’il a envie de leur faire payer leur décision, mais ce n’est pas de cette façon-là qu’on répond de manière constructive. On ne peut en effet pas simplement dire aux Britanniques qu’on attend leur lettre de sortie, puis au revoir, merci. Il convient d’essayer de comprendre leur désarroi. Le vote britannique est un vote européen et reflète ce malaise européen. Il faut qu’on réfléchisse aussi avec eux sur la façon dont l’UE peut améliorer son image, gagner en termes de légitimité politique, et avoir un projet vis-à-vis duquel les gens se sentent solidaires. Aujourd’hui, c’est impossible. Vous ne pouvez pas mobiliser une opinion publique dans la vie politique sans un projet phare, sans quelque chose qui vous donne envie d’y participer.
En ce sens, il aurait été intéressant que le triumvirat Junker, Schulz et le Président de la BCE arrivent ensemble et fassent une proposition très concrète aux Européens, du type: voilà, les Britanniques ont voulu sanctionner la libre circulation des personnes, nous on prend le contre-pied, on met sur pied un abonnement de 50 euros qui vous permet de voyager dans toute l’Europe avec les transports publics (train, bus); avec ce message : Britanniques, voyagez et rendez-vous compte par vous-mêmes que la libre circulation ne se réduit pas à une question de dumping salarial et d’emploi. C’est certes très populiste, mais une telle démarche aurait le mérite de montrer que les élites européennes ont compris.
Les gens ont à la fois envie de choses très concrètes, et ils ont besoin de grands objectifs. Il suffit de prendre le pouls, à Nuit debout, au sein de Podemos, au sein de Syriza, etc.. Nos sociétés en Europe sont traversées par des problématiques économiques, sociales, migratoires, identitaires, auxquelles l’UE n’apporte pour l’instant aucune réponse.
Si vous le voulez bien, passons à présent aux effets du vote britannique à proprement parler. Vous parliez plus tôt d’European bashing, on est en plein dedans… Car après le référendum sur l’appartenance du Royaume-Uni à l’Union européenne, Bruxelles perd pour la première fois l’un de ses membres. Et aux quatre coins du continent, les partis eurosceptiques – à l’image du Front national – jubilent et n’ont pas tardé à exiger des référendums sur le modèle britannique dans leur pays respectif. Bien que le Royaume-Uni ait une longue tradition de résistance aux processus d’intégration européenne et constitue en ce sens un cas à part, le Brexit peut-il selon vous déclencher un “effet domino”, marquant le début de la désintégration politique de l’Union?
F.E.: Concernant les consultations citoyennes au niveau européen, un élément est particulièrement intéressant. Leurs plus ardents partisans ont toujours été soit les partis eurosceptiques, soit des partis nationalistes. Le premier de ces partis, dont le programme était justement d’organiser un référendum sur la sortie du Royaume-Uni de l’Union, fut le Referendum Party créé par Sir James Goldsmith dans les années nonante. Une sorte d’Ukip avant l’heure, si vous voulez. Les consultations citoyennes au niveau européen séduisent les eurosceptiques et les opposants de par la logique guillotine du référendum, car vous êtes dans une démarche négative – puisque contre des lois – et non propositionnelle. Il est vrai que cette solution peut présenter des risques – organiser un vote similaire actuellement, c’est tendre le bâton pour se faire frapper – mais dans le même temps, j’ai envie de vous répondre en démocrate. Je pense que lorsqu’une démocratie est attaquée, il faut y répondre avec des arguments démocratiques, et montrer qu’une campagne n’est pas perdue d’avance.
Prenons l’exemple de la France. Convoquer aujourd’hui un référendum sur l’Europe, dans la perspective des élections présidentielles à venir et dans un contexte où le président et son gouvernement sont en perdition, c’est aller certainement au devant d’un résultat négatif. Je pense que, même en faisant une campagne très solide, il serait difficile d’inverser cette tendance, en raison de la tradition plébiscitaire en France : le vote serait finalement interprété à la fois contre François Hollande et contre l’Europe. Alors certes, c’est casse-gueule, mais cela ne veut pas dire pour autant que ce genre de vote soit perdu d’avance.
On a beaucoup décrié l’arme référendaire, mais il existe aussi des bons exemples. Des enseignements peuvent par exemple être tirés de l’“expérience” suisse. La Suisse en apprend encore tous les jours sur son modèle, notamment le fait qu’une campagne peut aussi se gagner sur le terrain et non pas uniquement sur la base d’arguments nationalistes. Ceux qui présentent l’exemple du Brexit comme une victoire pour eux-mêmes – voyez le Front national et son projet de “Frexit” qui moi me fait plutôt sourire – veulent profiter de l’outil référendaire par opportunisme politique en l’instrumentalisant pour servir leurs propres intérêts. En Suisse, cela a aussi été le cas ces dernières décennies. Le référendum a été utilisé par l’UDC pour mettre à mal certaines des grandes valeurs et projets politiques de notre pays, notamment lors des initiatives contre les minarets ou au sujet des relations Suisse-Europe.
Cet outil peut potentiellement faire beaucoup de mal et on note actuellement une tendance clairement identifiable d’utiliser les référendums avec la volonté de détruire le projet européen. Mais une fois l’onde de choc du Brexit passée, la vague va se calmer. Cette tendance est instructive. Je pense qu’il ne faut surtout pas disqualifier le référendum en disant qu’il est l’instrument des extrémistes. C’est un réel défi démocratique pour les États membres, voire pour l’Union.
Maintenant pour les conséquences, j’ai envie de dire “tout est ouvert”. Il est très difficile aujourd’hui de dire ce qu’il va se passer. Si on prend l’exemple de la position britannique, on s’aperçoit qu’elle a déjà évolué en l’espace de quelques jours. Ils ne sont plus tout à fait sûrs de vouloir vraiment sortir ou souhaitent en tout cas des garanties avant de le faire. Tout ce que l’on sait formellement, c’est que les Britanniques disposent d’un délai de deux ans pour sortir de l’UE. Que vont-ils obtenir maintenant? Ça personne ne le sait. De son côté, l’UE a plutôt envie de punir les Britanniques, et pas de leur faire de concessions. Toutefois, l’affaiblissement d’un partenaire commercial très fort n’est jamais bon pour l’Europe, car l’économie européenne est elle aussi impactée. Si effet domino il y aura, je le vois plutôt sur la volonté d’organiser des référendums ailleurs en Europe.
Mais cet effet domino pourrait, selon moi, également être observé par rapport à la gestion des affaires européennes, à l’interne et à l’extérieur.
A l’intérieur, certains membres vont observer très attentivement ce que les Britanniques vont obtenir et il y a fort à craindre que ce qui constituait jusqu’à présent un cas spécifique, comme la Suisse, devienne plus récurrent. Et à ce sujet, il existe un vrai risque sur le principe de la libre circulation des personnes. L’Europe a toujours dit que cette valeur était fondamentale, non-négociable, mais elle a toutefois fini par céder à la Suisse. Ceci pourrait donner des idées à d’autres États membres. Il y a là un véritable enjeu, car si l’UE présente une flexibilité institutionnelle – l’euro, Schengen – il n’existe pour l’heure pas de flexibilité thématique. L’Europe est déjà à deux vitesses, mais ne pourrions-nous pas institutionnaliser cet état de fait en créant par exemple un noyau dur d’États sur certains gros dossiers – question migratoire, question économique et sociale?
Vis-à-vis de l’extérieur, les conséquences du Brexit concernent autant la Suisse que les autres partenaires. Est-ce qu’un pôle concurrent à l’UE va émerger? Jusqu’à présent, l’UE était la seule puissance continentale régionale. L’Otan a plutôt trait à des questions de sécurité militaire et l’OSCE à la sécurité internationale au sens large. Puis on a l’AELE qui subsiste aujourd’hui avec un nombre limité d’États: la Norvège, le Liechtenstein et la Suisse. Cette dernière est le seul membre de l’AELE qui n’est en même temps pas membre de l’EEE. Peut-être que les Britanniques vont y revenir après l’avoir quittée en 1972 pour rejoindre l’UE, parce que c’était plus intéressant économiquement. L’AELE pourrait ainsi devenir un nouveau pôle avec lequel l’UE va devoir repenser ses relations. L’hégémonie continentale de l’UE va peut-être être mise à mal par l’émergence de ce nouveau pôle, bien qu’il soit limité au terrain économique.

Affiche de l’UDC dans le cadre de la campagne en faveur de l’initiative « contre l’immigration de masse », votée le 9 février 2014
Qu’en est-il spécifiquement des conséquences potentielles pour la Suisse dans le contexte de l’après 9-Février? Faut-il s’alarmer à la manière de certains diplomates ou au contraire y voir une opportunité?
F.E.: Il existe plusieurs scénarios. On a premièrement les partisans, dont Micheline Calmy-Rey fait partie, de l’idée selon laquelle le Brexit va faire les affaires de la Suisse. Dans la mesure où le Royaume-Uni et la Suisse sont tous deux dans la situation de devoir négocier avec l’UE, notre pays pourrait disposer d’un levier sur lequel il ne pouvait pas compter depuis le 9-Février et jusqu’à présent. C’est un scénario qui privilégie la montre pour la Suisse: attendre de voir ce que vont négocier les Britanniques et ne pas lier nos négociations aux leurs, sachant que nous avons un statut différent, notamment en termes de libre circulation des personnes.
Ensuite, un autre scénario prédit une situation de grande instabilité pour la Suisse, simplement parce que l’UE va désormais être focalisée sur la résolution du cas britannique et la sortie du Royaume-Uni de l’Union, et qu’elle sera moins disponible pour la Suisse. Alors certes, des commissaires européens sont directement en charge de notre dossier. Néanmoins, Jacques de Watteville, le négociateur en chef suisse auprès de l’UE, devait être reçu lundi à la Commission européenne et le rendez-vous a été annulé. On peut évidemment dire que le contexte est un peu exceptionnel, mais il n’en reste pas moins que la place de la Suisse sur l’agenda est très discutable.
L’UE a-t-elle vraiment intérêt à laisser flotter la Suisse dans sa situation? Je pense qu’ils ont eux aussi envie de clarifier le cas suisse. Donc je dirais que celui-ci est un troisième scénario, à cheval entre les deux précédents. La Suisse pourrait peut-être ressortir gagnante de ces temps extrêmement incertains. Elle pourrait se justifier ainsi auprès des Chambres et demander une prolongation du délai pour remettre l’arrêt relatif aux contingents qu’impose l’initiative du 9-Février. La Suisse pourrait même se permettre le luxe de proposer un contingent qui déroge aux règles de la libre circulation des personnes et je suis sûr que l’UE n’aura pas l’énergie de condamner la Suisse en lui reprochant de violer l’accord.
Et parmi ces scénarios, lequel vous semble le plus vraisemblable?
F.E.: Stratégiquement, je pense personnellement qu’il vaut mieux attendre et ne rien faire dans l’immédiat, voir ce que les Britanniques vont négocier et agir en fonction de ces résultats. Car à l’heure actuelle, les Britanniques demandent quand même le service complet! Ils désirent la libre circulation pour leurs citoyens mais surtout pas pour ceux qui viennent chez eux. En revanche, je ne crois pas au scénario postulant que la Suisse ressorte gagnante du vote britannique. A l’heure actuelle, tout reste ouvert, que ce soit pour les conséquences du Brexit sur les États membres ou les conséquences du Brexit sur la Suisse. Jouer la montre et gagner du temps, c’est le seul moyen pour la Suisse de tirer un avantage de cette situation.
Vous évoquiez précédemment l’arme à double-tranchant du référendum. Après le Brexit, on a pu entendre la Première ministre écossaise appeler à un nouveau référendum sur l’indépendance de l’Écosse. Existe-t-il en ce sens un risque de (re)balkanisation de l’Europe, selon vous? Est-il envisageable de voir émerger à terme une “Europe des régions”, quand on connaît les velléités d’indépendances de certains, en Catalogne et ailleurs?
F.E.: Au moment du référendum sur l’indépendance en Écosse ou après les élections remportées par les indépendantistes en Catalogne, on a effectivement craint une balkanisation de l’Europe. Mais finalement, cela n’a pas été le cas puisque ni les Basques, ni les Corses, si je prends ces exemples-là, n’ont demandé à être consultés. Les cas écossais et catalans sont donc très spécifiques.
En revanche, le risque d’instabilité que pourrait générer à l’intérieur même du Royaume-Uni cette situation est quant à lui élevé. Si les Écossais sont à nouveau appelés aux urnes, si un tel scénario s’étend aussi à l’Irlande, où le Sinn Féin a demandé un référendum sur la réunification de l’Irlande et l’Irlande du Nord, l’éclatement du Royaume-Uni et, par voie de conséquence de l’Union, devient envisageable.
En réalité, il est intéressant de noter qu’on a pensé que les exemples écossais et catalans allaient réveiller ailleurs des velléités d’indépendance, mais celles-ci sont des velléités d’indépendance “d’appartenance”, c’est-à-dire de rupture avec le Royaume-Uni certes, mais aussi des cris du coeur européens. A l’exception du pays de Galles, les Écossais et les Nord-Irlandais ont dit “nous ne voyons pas notre avenir en dehors de l’Union”. C’est aussi quelque part rassurant – il y a bien des régions d’Europe qui voient leur avenir dans l’UE.
L’importance des régions a été constatée depuis longtemps. Par contre, elles ne disposent pas encore d’espace politique propre, en dehors du Comité des Régions qui est purement consultatif dans le processus législatif. Or, on le voit avec les référendums, les États ont de plus en plus de peine à trouver leur place dans l’espace politique européen. Vous posez là une bonne question, car je pense que l’avenir du projet européen pourrait passer par une régionalisation plus poussée en reconnaissant les compétences des régions à leur échelle d’une part, voire par la création de régions européennes d’autre part. On sortirait ainsi des logiques nationales.
Quel est le point commun entre une région administrative portugaise et un Land allemand? Avec un peu d’arrogance, ces derniers ne comprenaient pas pourquoi leurs collègues portugais, prétendument privés de compétences fiscales et économiques et ne disposant d’aucun budget, venaient siéger avec eux au sein du Comité des Régions. Mais les Allemands se sont bien vite rendus compte que bien que les compétences étaient peut-être différentes, les problématiques, elles, étaient identiques.
Une culture régionale s’est ainsi incontestablement créée au niveau européen. Mais de quelles régions parlons-nous? Celles qui existent déjà ou faut-il en créer d’autres qui soient transnationales? Si on prend l’exemple de Genève, on s’aperçoit que la particularité franco-valdo-genevoise est tout à fait passionnante et ne possède pas d’équivalents au niveau européen. Il y a donc bel et bien un enjeu de politique publique qui se joue au niveau des régions. Est-ce que la région comme unité de base constituera le nouveau logiciel du projet européen? C’est une possibilité à prendre en considération, car l’État-nation n’est plus le seul échelon pertinent pour définir et construire les politiques de demain.




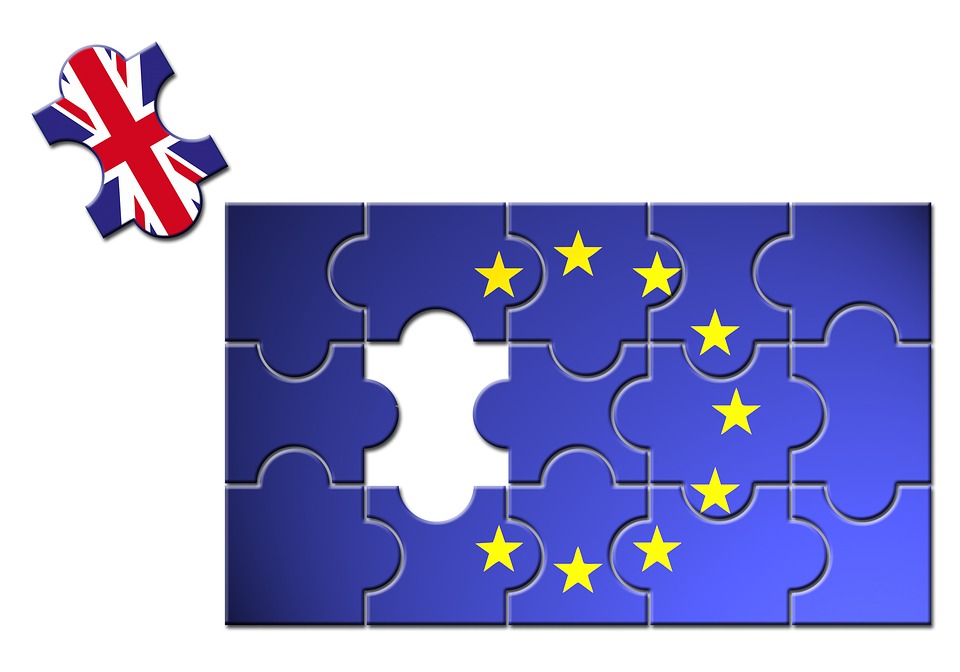

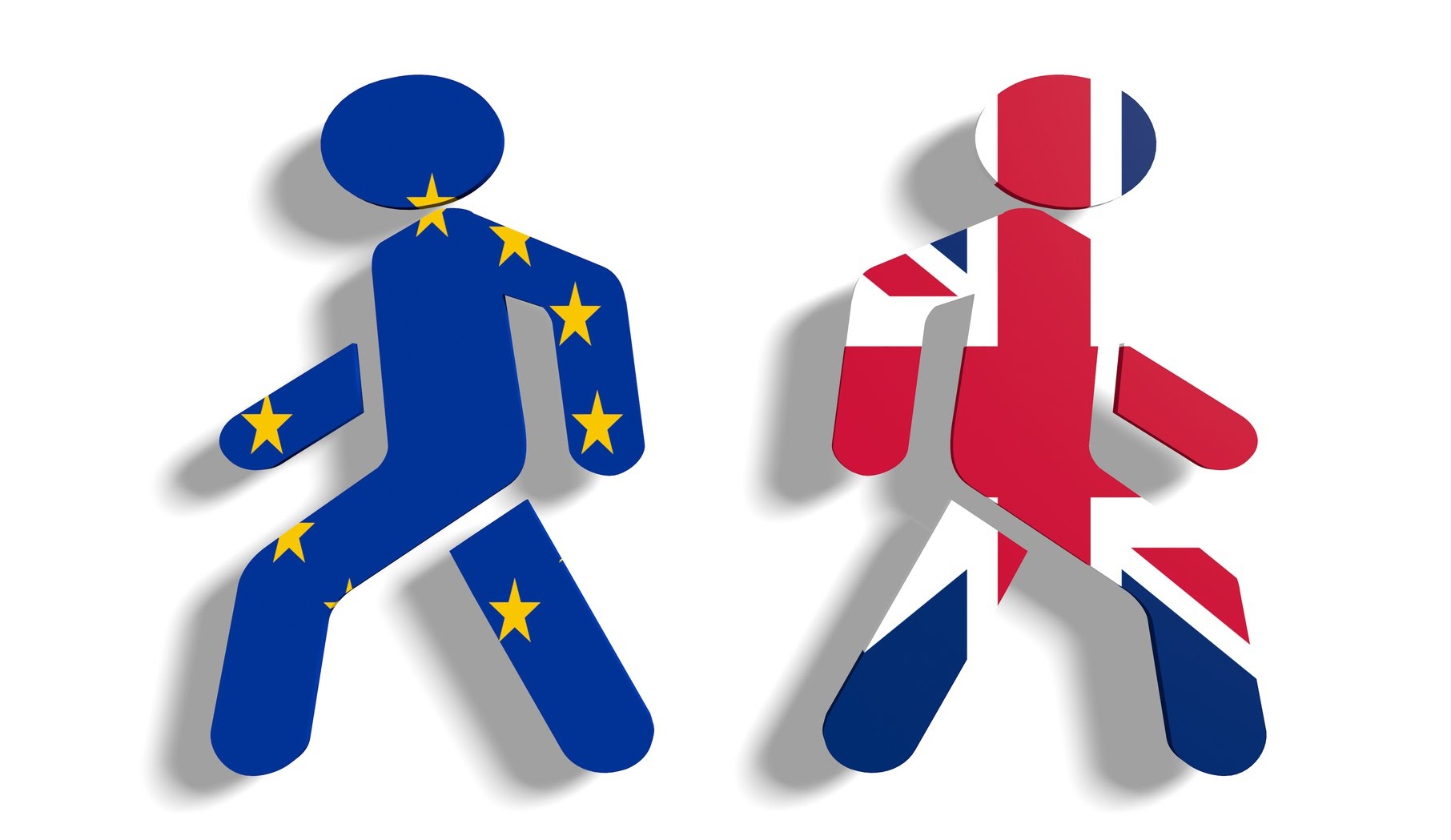

S'il vous plaît écrire régulièrement parce que j'aime vraiment vos messages. Merci beaucoup!