
Avouons-le : jusqu’au petit matin du 24 juin 2016, personne ne croyait vraiment que les Britanniques allaient voter pour le « Brexit ». Maintenant que le désastre est arrivé, il est tentant de se sentir découragé, et d’abandonner tout rêve de refondation démocratique et progressiste de l’Europe. Il faut pourtant persévérer et reprendre espoir, car il n’existe pas d’autre option : la montée des égoïsmes nationaux et de la xénophobie en Europe nous conduit tout droit à la catastrophe. Reprenons le fil des événements, et voyons ce qu’il faudrait changer et clarifier pour reconstruire l’Europe après le Brexit.
Cela a déjà été dit et redit : dans bien des cas, le vote Brexit exprime davantage un vote contre l’immigration et la mondialisation qu’un vote contre l’Union européenne en tant que telle. Cette attitude de repli xénophobe, que l’on connaît bien en France avec le vote FN, et maintenant aux États-Unis avec le vote Trump, même si l’insularité britannique a aussi ses spécificités, a quelque chose de profondément nihiliste et irrationnel : ce n’est pas en stigmatisant toujours plus les travailleurs immigrés et les pays et cultures étrangères que l’on va résoudre les problèmes, bien au contraire.
Et ce n’est évidemment pas en se plaçant en dehors du seul cadre européen existant de délibération collective, aussi imparfait soit-il, que le Royaume-Uni va trouver sa voie.
Renforcement des tendances inégalitaires de la mondialisation
Tout cela est vrai, mais il faut préciser deux points. Tout d’abord, ce vote est également une réaction au fait que les institutions européennes, toutes entières tournées vers le principe d’une concurrence toujours plus pure et plus parfaite entre territoires et entre pays, sans socle social et fiscal commun, n’ont fait objectivement que renforcer les tendances lourdement inégalitaires de la mondialisation à l’œuvre au cours des dernières décennies.
Face à l’absence de réponse démocratique et progressiste, il n’est pas étonnant que les classes populaires et moyennes finissent par se tourner vers les forces xénophobes. Il s’agit d’une réponse pathologique à un abandon bien réel. Née d’un projet de projet de marché commun adapté à la reconstruction et à la croissance des années 1950-1970, la construction européenne n’a jamais su se transformer en force efficace de régulation du capitalisme mondialisé et financier en plein essor depuis les années 1980-1990.
Ensuite, la vérité oblige à dire que le UKIP ou le FN ne sont malheureusement pas les seules forces politiques à avoir succombé à la montée des égoïsmes nationaux et à l’irrationalité collective au cours des dernières années. En particulier, c’est l’égoïsme à courte vue et la montée du « chacun pour soi » qui expliquent la gestion catastrophique de la crise financière par les pays de la zone euro depuis 2008.
Les gouvernements de centre droit et de centre gauche (CDU, UMP, PS) qui se sont succédé au pouvoir des deux côtés du Rhin portent de ce point de vue une écrasante responsabilité historique, qu’il faudra bien reconnaître un jour. En Allemagne, le discours tenu depuis bientôt dix ans n’a quasiment pas varié d’une virgule : si les autres pays de la zone euro faisaient la même chose que nous, adoptaient les mêmes réformes, se comportaient avec la même fiabilité et la même vertu, etc., alors tout irait pour le mieux dans le meilleur des mondes.
Discours irrationnel
Le problème de ce discours moralisateur, donneur de leçons et nationaliste est qu’il est totalement irrationnel. Non pas qu’il n’y ait quelques bonnes choses à apprendre dans le modèle industriel et social allemand, évidemment. Le problème est que si chaque pays de la zone euro avait appliqué la même politique de déflation salariale généralisée, et se retrouvait aujourd’hui avec le même excédent commercial gigantesque de 8 % du PIB, totalement inédit dans l’histoire depuis la révolution industrielle, alors par définition il n’existerait personne au monde pour absorber un tel excédent.
Les responsables allemands se refusent toujours à expliquer à leur opinion cette réalité factuelle, évidente pour le reste du monde et pour l’histoire : à savoir que leur haut niveau d’activité économique et d’emploi a été obtenu pour une bonne part au détriment des voisins. Avec plusieurs monnaies, il aurait suffi de dévaluer fortement les monnaies du sud de l’Europe ; mais à partir du moment où l’on faisait le choix de conserver la monnaie unique, alors il aurait fallu – et il faut toujours – relancer massivement les salaires et l’investissement public en Allemagne, et mettre en place une union fiscale et budgétaire.
Quant à la France, qui aime se servir de l’Allemagne comme d’une mauvaise excuse pour ne rien faire, la vérité est que c’est parce qu’elle a bénéficié des mêmes taux d’intérêt ultra faibles que son voisin allemand, qu’elle a choisi de laisser tomber l’Europe du Sud. Conséquence de tout cela : les responsables de la zone euro ont imposé des politiques d’hyper-austérité qui ont fait replonger la zone dans une récession absurde en 2011-2013, à rebours du reste du monde, et dont on se remet à peine.
Boulet pour l’Europe
C’est ainsi que la zone euro est devenue un boulet pour l’Europe, ce que les tenants du Brexit n’ont pas manqué d’exploiter dans la campagne qui s’achève : à quoi bon rester avec des pays qui nous tirent vers le bas, et qui se sont montrés incapables de gérer correctement leur union monétaire ? L’euro devait marquer la transformation du marché commun en union politique, capable de nous protéger face à la spéculation des marchés, première étape vers une puissance publique permettant de réguler le capitalisme du XXIe siècle. En réalité, l’euro est devenu la machine infernale qui menace de tout faire dérailler.
Que faire aujourd’hui ? Il faut tout d’abord clarifier le fait que l’Union européenne ne peut se réduire à une vaste zone de libre circulation des marchandises, des services et des capitaux, sans aucune contrepartie fiscale, sociale et réglementaire. Pour être durable, la croissance économique a besoin de services publics, d’infrastructures, de systèmes d’éducation, de recherche, de santé, d’échanges universitaires, de péréquation régionale, d’égalité des chances, et tout cela à un coût.
Le Royaume-Uni va maintenant chercher à obtenir un statut analogue à celui de la Norvège, de l’Islande et de la Suisse. Il est plus que temps de rappeler aux Britanniques – et cela aurait pu changer le cours des choses si cela avait été fait plus tôt par les gouvernements allemands et français, en toute transparence – que cela ne se fera pas gratuitement.
La Norvège et l’Islande font partie de l’Espace économique européen (EEE), ce qui leur garantit un accès plein et entier au marché commun. Mais ces deux pays doivent en contrepartie appliquer la quasi-totalité de la législation de l’Union, et acquitter une contribution à son budget (voisine de la contribution britannique actuelle, si on l’exprime en pourcentage du PIB), tout cela sans participer à la prise de décision collective. Il faudrait d’ailleurs en profiter pour appliquer les mêmes règles à la Suisse, qui bénéficie actuellement d’un statut privilégié (sa contribution budgétaire est moitié moindre).
Sanctions contre le dumping réglementaire
Surtout, au-delà de la question de la contribution budgétaire permanente des pays non membres de l’Union souhaitant bénéficier du marché commun, il est temps de mettre sur la table la question des sanctions applicables aux pays pratiquant le dumping réglementaire, et en particulier aux pays qui n’appliqueraient pas des règles strictes en matière de transparence financière et de lutte contre l’optimisation fiscale.
Il n’est pas normal que l’on ait dû attendre les sanctions américaines pour que le secret bancaire suisse commence (timidement) à être remis en cause. Les calculs de Gabriel Zucman (La richesse cachée des nations, Seuil 2014, traduit en de nombreuses langues) montrent que les bénéfices apportés à la Suisse par le secret bancaire sont équivalents à ce que coûterait au pays des droits de douane de l’ordre de 30 % appliqués par ses trois principaux voisins (Allemagne, France, et Italie).
La même question va se poser pour la place financière de Londres et les paradis fiscaux de la couronne britannique. Il faudra évaluer rigoureusement les dommages imposés aux autres, et appliquer des sanctions en rapport avec ces montants.
Bénéficier du marché commun tout en siphonnant la base fiscale des voisins
Tant que l’on n’est pas prêt à imposer des sanctions de ce type, alors il ne faudra pas s’étonner que des pays choisissent de prospérer en dehors de l’Union européenne : s’il est possible de bénéficier du marché commun, tout en siphonnant tranquillement la base fiscale des voisins, pourquoi se priver ? Le système légal et politique dans lequel s’est enferrée l’Europe, qui repose in fine sur une sacralisation de la libre circulation et du marché libre, sans contrepartie sérieuse en termes de régulation collective, nous conduit tout droit à des « Brexit » en série.
Ensuite, si l’on souhaite sauver la zone euro, il va falloir fondamentalement changer son cours. Après la victoire électorale de Syriza en Grèce en janvier 2015 (elle-même conséquence du refus obstiné des Européens d’engager la restructuration de dette pourtant promise au précédent gouvernement grec), les dirigeants de la zone euro ont fait le choix absurde de vouloir humilier le pays, afin d’éviter que d’autres électeurs ne soient tentés par l’aventure.
Ce choix a en partie payé, puisque Podemos n’a pu faire mieux que jeu égal avec le PSOE lors des doubles élections espagnoles de décembre 2015 et juin 2016. Sauf que l’Espagne est aujourd’hui ingouvernable, et que les dirigeants français et allemands se retrouvent maintenant confrontés un peu partout à la montée du populisme de droite et du nationalisme, au Royaume-Uni comme en Pologne et en Hongrie. Cette menace est autrement plus dangereuse pour l’Europe que le défi posé par la gauche radicale, qui dans le fond ne fait que formuler une demande de bon sens : la restructuration des dettes publiques européennes est inévitable et doit être organisée au plus vite. Il aurait mieux fallu tenter de s’appuyer sur Syriza, Podemos, le PSOE et l’ensemble des partis de gauche radicale ou non, qui ont le mérite d’être fondamentalement proeuropéens, par comparaison aux populistes de droite.
Il est navrant de constater qu’aujourd’hui encore, les dirigeants européens continuent d’exiger de la Grèce qu’elle dégage un excédent budgétaire primaire de 3,5 % du PIB pour les décennies qui viennent, tout cela dans un pays dont le niveau d’activité économique est un quart plus faible qu’en 2008, et où le chômage a explosé, ce qui n’a strictement aucun sens. Il est normal de demander à un pays un léger excédent, de l’ordre de 0,5 % ou 1 % du PIB, mais pas davantage. La décision vient de nouveau d’être repoussée à la fin de l’année, et il y a fort à parier que ce ne soit pas la dernière fois.
Moratoire sur les dettes européennes
Plus généralement, il est urgent de mettre en place un moratoire sur les dettes européennes, tant que la zone n’aura pas retrouvé une croissance robuste, et de lancer un programme d’investissement dans les infrastructures, la formation et la recherche. Le secteur privé a aujourd’hui peur d’investir, comme le montrent les taux d’intérêt négatifs actuellement appliqués, et sans relance publique il existe un risque réel que la zone euro s’éternise dans un régime de croissance molle et d’inflation quasi-nulle, voire négative.
L’histoire démontre qu’il est impossible de réduire un endettement public élevé dans de telles conditions, et qu’il vaut mieux avoir le courage de restructurer clairement les dettes lorsqu’elles deviennent impossibles à rembourser pour les nouvelles générations (ce dont a d’ailleurs bénéficié fortement l’Allemagne lors de l’annulation de sa dette dans les années 1950). La création monétaire et le développement de nouvelles bulles sur les prix des actifs ne résoudront pas le problème à la place des gouvernements, bien au contraire.
Enfin, si l’on souhaite véritablement avancer sur toutes ces questions, alors le débat institutionnel ne pourra être évité. On peut toujours bricoler des compromis dans l’urgence à partir des institutions actuelles. Mais à terme, si l’on souhaite pouvoir adopter démocratiquement et sereinement un plan de relance au sein de la zone euro, une restructuration des dettes, un impôt commun sur les bénéfices des sociétés, etc., alors une refondation démocratique s’impose.
Il existe une théorie selon laquelle les institutions européennes auraient atteint une sorte de perfection indépassable avec le traité constitutionnel européen de 2005 (finalement adopté en 2008 avec le traité de Lisbonne), et que tout irait pour le mieux si les responsables politiques nationaux et les opinions publiques se saisissaient enfin de ces institutions merveilleuses et cessaient d’être stupidement europhobes.
Bicaméralisme de façade et machine à faire détester l’Europe
En vérité, les institutions européennes actuelles sont gravement dysfonctionnelles. Elles reposent sur un bicaméralisme de façade : d’un côté, le Conseil européen des chefs d’États (et ses déclinaisons au niveau ministériel : Conseil des ministres des finances, Conseil des ministres de l’agriculture, etc.) ; de l’autre, le Parlement européen (élu directement par les citoyens). En principe, les textes législatifs européens doivent être approuvés par ces deux chambres. En pratique, l’essentiel du pouvoir est détenu par le Conseil européen et les Conseils ministériels, qui le plus souvent doivent statuer à la règle de l’unanimité (notamment sur la fiscalité, ce qui empêche toute avancée réelle), et qui, dans les rares cas où s’applique la règle de la majorité, continuent toujours de délibérer à huis clos.
En vérité, le Conseil européen est une machine à dresser les intérêts nationaux les uns contre les autres, une machine à empêcher toute possibilité de faire émerger des délibérations démocratiques et des décisions majoritaires au niveau européen. A partir du moment où vous demandez à une personne (chef d’État ou ministre des finances) de représenter à elle seule 82 millions d’Allemands ou 65 millions de Français, ou encore 11 millions de Grecs, il est impossible d’avoir une délibération démocratique apaisée aboutissant à la mise en minorité de l’une ou l’autre de ces personnes.
C’est ce système institutionnel, doublé de multiples règles visant à contourner la démocratie (unanimité sur la fiscalité, règles automatiques sur les critères budgétaires), qui produit l’inertie et l’incapacité d’agir en Europe. Chacun défend ce qu’il croit être ses intérêts nationaux, et en vérité personne n’en sait rien, puisque tout cela se passe à huis clos. Ces Conseils européens nous annoncent régulièrement au milieu de la nuit qu’ils ont sauvé l’Europe, avant que l’on ne se rende compte dans la journée qui suit qu’ils ne savent pas eux-mêmes ce qu’ils ont décidé. Cette structure institutionnelle est une machine à faire détester l’Europe.
Évolutions possibles
Face à ce blocage, plusieurs évolutions sont possibles. Certains europhiles proposent de réduire drastiquement le rôle du Conseil européen et de confier l’essentiel du pouvoir au Parlement européen (voir par exemple Laurent Joffrin il y a quelques jours dans Libération). Cette solution a le mérite de la simplicité. Mais elle a l’inconvénient de faire totalement l’impasse sur les institutions politiques nationales, ce qui risque fort de provoquer l’hostilité de ces dernières et les « Brexit » en cascade.
Il me semble plus prometteur d’imaginer une forme originale de bicaméralisme européen, fondée d’une part sur le Parlement européen (élu directement par les citoyens), et d’autre part sur une nouvelle Chambre parlementaire composée de représentants des Parlements nationaux, en proportion de la population de chaque pays et des groupes politiques présents dans chaque Parlement.
Cette Chambre parlementaire comporterait par exemple une quarantaine de membres du Bundestag, une trentaine de membres de l’Assemblée nationale, etc., et se réunirait environ une semaine par mois, pour trancher notamment les décisions budgétaires et financières engageant directement les contribuables nationaux : choix du niveau de déficit budgétaire au sein de la zone euro, supervision du Mécanisme européen de stabilité, budget de la zone euro, restructuration des dettes, etc.
On peut imaginer pour cela différentes règles de majorité qualifiée, qui dans tous les cas seraient plus satisfaisantes que la situation actuelle, où chaque Parlement national dispose de facto d’un droit de veto, ce qui pose de redoutables problèmes de légitimité démocratique (Bundestag contre Parlement grec, etc.) et conduit le plus souvent au blocage. En donnant la possibilité aux députés nationaux de siéger les uns aux côtés des autres et de prendre des décisions majoritaires, à l’issue de délibérations publiques et démocratiques, on peut au moins espérer faire des progrès dans la bonne direction.
Démocratie parlementaire
Cette forme originale de bicaméralisme diffère des structures classiques de bicaméralisme (Assemblée/Sénat en France, Bundestag/Bundesrat en Allemagne, Chambre/Sénat aux États-Unis) et correspond, me semble-t-il, au caractère unique de la construction européenne, qui s’appuie sur de vieux États-nations qui ont réussi à construire au fil des décennies des formes extrêmement élaborées d’État social, en s’appuyant sur la démocratie parlementaire dans le cadre national.
Il ne me semble ni réaliste ni souhaitable de prétendre bâtir une souveraineté parlementaire européenne en contournant les Parlements nationaux, qui malgré tous leurs défauts, demeurent les structures démocratiques essentielles qui ont permis depuis des décennies de voter des prélèvements et des budgets sociaux représentant des dizaines de points de PIB, avec à la clé, une progression du bien-être social et une amélioration des conditions de vie inédites dans l’histoire du monde. Il paraît plus judicieux de transformer progressivement les législateurs nationaux en co-législateurs européens, en les contraignant à prendre en compte l’intérêt général européen, et en les empêchant de se contenter de se plaindre de l’Europe.
Le débat est ouvert, et il mérite des discussions approfondies. Il faut également éviter qu’il s’arrête trop vite sur des malentendus. Trop souvent, lorsque l’on évoque cette question du rôle des Parlements nationaux, on entend les réactions énervées des europhiles, et notamment des proches du Parlement européen, qui voient de telles propositions comme un insupportable retour en arrière.
Un véritable pouvoir législatif en lieu et place du Conseil européen
De fait, avant la première élection au suffrage universel du Parlement européen, en 1979, ce dernier n’était qu’une Assemblée parlementaire composée de représentants des parlements nationaux, avec un rôle purement consultatif. Mais la proposition défendue ici est totalement différente : il s’agit de donner à cette Chambre parlementaire européenne issue des Parlements nationaux un véritable pouvoir législatif, en lieu et place du Conseil européen (qui ne sera jamais une véritable chambre législative). Ce qui, dans le fond, permettrait de renforcer la logique parlementaire défendue par le Parlement européen, et constitue sans doute la seule façon de dépasser les blocages actuels.
Mais les vieux démons ont la vie dure, et il est à craindre que ces réactions ne disparaîtront pas de sitôt. Il y a quelques jours, Jean-Pierre Chevènement, éternel défenseur de l’Europe des nations, proposait dans Le Monde de renforcer le pouvoir du Conseil européen (qui est pourtant tout sauf un lieu de délibération démocratique), tout en suggérant que le Parlement européen soit issu des Parlements nationaux (ce qui ne manquera pas d’agacer les euro-parlementaires), sans toutefois préciser sous quelle forme et avec quels pouvoirs.
Certains membres du Parlement européen, comme par exemple Yannick Jadot ou Henri Weber, proposent une solution mixte, avec un Parlement de la zone euro, composé pour partie de parlementaires européens et nationaux. Cela ne me semble pas être la solution la plus lisible, mais le débat est légitime.
En tout état de cause, ce débat sur les institutions européennes est fondamental, et il ne doit pas être réservé aux experts du droit et des constitutions : il concerne tous les citoyens, de même que les débats sur l’impôt ou sur la dette. Ces questions ont trop longtemps été abandonnées à d’autres, avec les résultats que l’on sait. Il est temps que les citoyens de l’Europe se réapproprient l’avenir.
Cet article a été publié sur le blog de Thomas Piketty, hébergé par Le Monde.


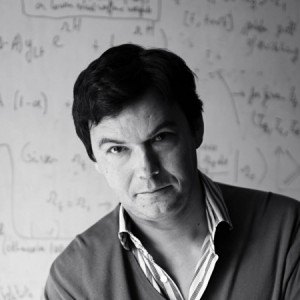

Laisser un commentaire
Soyez le premier à laisser un commentaire