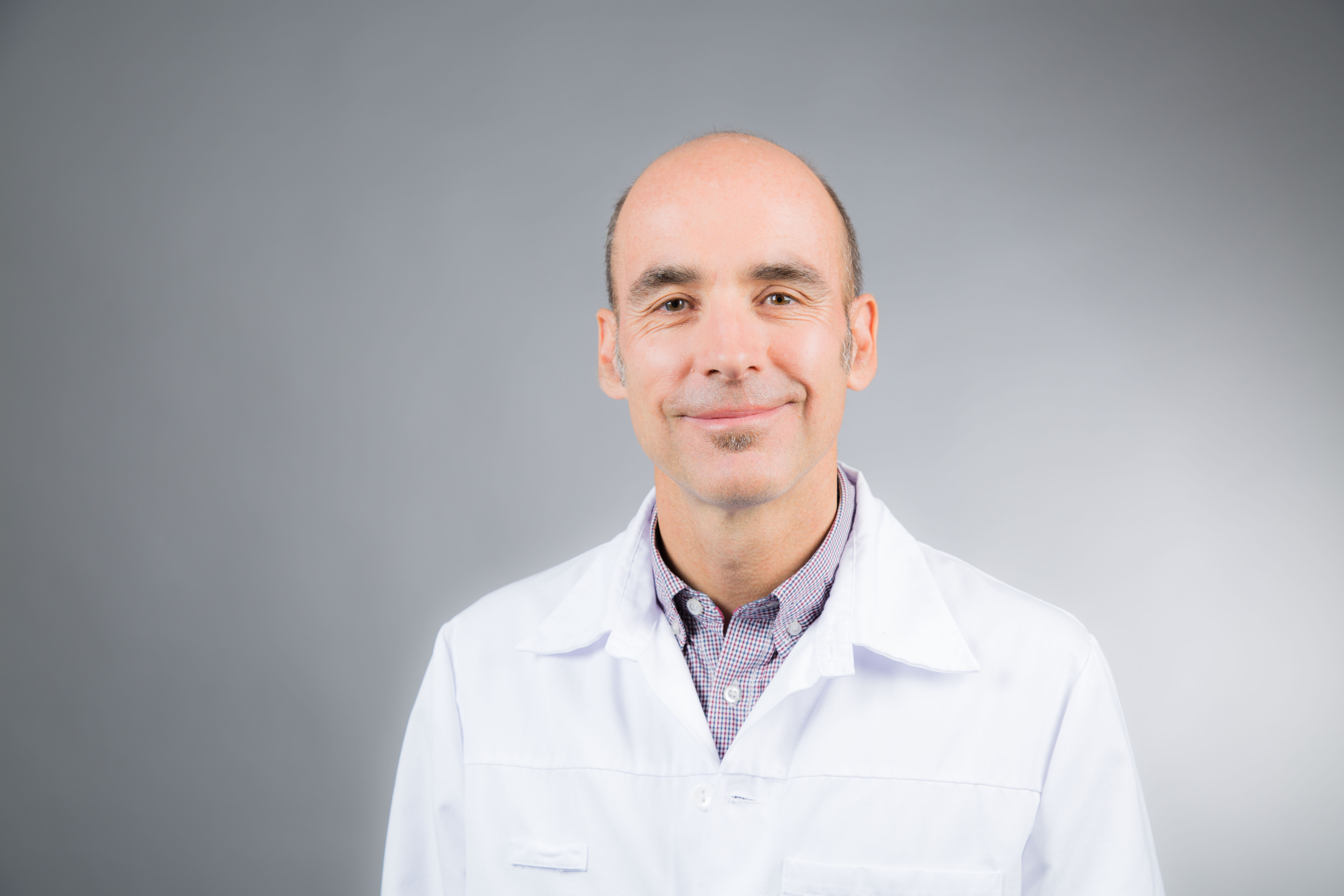
© Dr Yves Jackson
Suite du dossier sur les « sans-papiers » avec la question de la santé : pour aborder ce volet crucial, nous sommes allés à la rencontre d’un médecin pas tout à fait comme les autres qui, loin de circonscrire sa pratique médicale aux soins, l’envisage dans sa dimension sociale large en lien avec les populations les plus précaires. Entretien de fond avec le Dr Yves Jackson, médecin adjoint agrégé au service de médecine de premier recours des HUG et à la faculté de médecine de l’Université de Genève.
Vous êtes le responsable de de la consultation ambulatoire mobile de soins communautaires (CAMSCO) à Genève depuis 2008. Quelle mission les Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) poursuivent-ils à travers cette structure ? A qui s’adresse-t-elle ?
Dr Yves Jackson : La création de la CAMSCO est une réponse cantonale aux problèmes d’accès aux soins consécutifs à la mise en application de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal) en 1997. En effet, la nouvelle loi a rendu l’accès et le remboursement des soins dépendants de l’affiliation à une caisse-maladie. A Genève, certains acteurs de la santé et du social ont fait part de leur crainte au Conseil d’Etat que certaines populations puissent avoir des difficultés à accéder à l’assurance-maladie – et donc aux soins – pour des motifs sociaux, légaux et économiques. Le Conseil d’Etat fut sensible à cet argument et mandata les HUG nouvellement créés pour garder, d’une certaine manière, une porte ouverte dans le dispositif de soins publics pour des populations locales qui n’auraient plus accès aux soins, par absence d’assurance-maladie. La CAMSCO fut ainsi créée avec cinq missions à accomplir :
1. Permettre l’accès aux soins pour les populations précaires à Genève.
2. Assurer la coordination de programmes et d’interventions de santé à l’échelle cantonale pour ces populations.
3. Intégrer ces personnes dans le dispositif LAMal habituel, en ce sens qu’il ne s’agit pas de créer un système parallèle
4. Former des professionnels à la pratique de la médecine sociale.
5. Documenter les besoins de santé spécifiques et les obstacles dans l’accès aux soins. C’est précisément dans ce cadre-là que s’inscrit l’étude Parchemins.
Les « sans-papiers » ont-ils des besoins spécifiques par rapport à la population résidente en général et aux autres populations précaires en particulier ? Souffrent-ils de troubles qui les concernent spécifiquement ?
YJ : Il y a en effet quelques particularités, lesquelles sont pour certaines liées à l’origine géographique, et pour d’autres liées à l’aspect socio-économique et statutaire (légal).
Ces populations sans statut légal sont très cosmopolites en termes d’origine. Par conséquent, comme pour toute personne migrante, leur santé est en partie dépendante de l’endroit où une bonne partie de leur vie s’est déroulée avant la migration en Suisse. Par exemple, on sait que de nombreux pays qui se trouvent dans la strate de développement moyen sont en pleine transition épidémiologique de santé. Ils sont ainsi passés d’un fardeau de santé essentiellement lié à des maladies infectieuses à l’explosion des maladies chroniques (diabète, maladies cardio-vasculaires, etc.). Typiquement, l’état de santé des gens qui viennent d’Amérique latine est le reflet de l’explosion épidémiologique des maladies chroniques dans leur pays d’origine1. Pour nous, soignants ici en Suisse, il y a donc la nécessité de prendre en considération le paysage épidémiologique du pays d’origine. C’est l’aspect géographie : la provenance des gens prédispose à certains types de maladies.
D’un autre côté, l’effet du statut social, tant sur le plan économique (très bas) que sur le plan statutaire légal avec la situation de « sans-papier », a aussi intrinsèquement une influence à travers l’exposition à des conditions de vie difficiles qui va créer des nouvelles souffrances et des nouveaux problèmes de santé ou accentuer l’importance de maladies préexistantes.
Revenons aux maladies chroniques de type diabète. Comme on l’a vu, les personnes originaires de pays intermédiaires en termes de développement, où il y a le grand boom des maladies métaboliques (surpoids, obésité, diabète, hypertension, etc.), viennent avec un risque beaucoup plus grand d’avoir ces maladies-là. Dans le même temps, ces personnes sont transposées dans un système où leur capacité d’agir (agency en anglais), leurs ressources pour prendre soin d’elles, sont très différentes – souvent beaucoup plus basses. Par conséquent, leurs maladies auront tendance à être aggravées par le fait que les conditions de vie à Genève sont difficiles. Elles ne vont pas pouvoir les gérer correctement.
D’où l’importance fondamentale d’un accès aux soins précoce, compréhensif en termes de services de santé fournis et, surtout, de haute qualité. C’est ce que la CAMSCO et les HUG essaient de faire : éviter la dégradation de maladies préexistantes ou la survenue de nouvelles maladies liées à la précarité ici, par une intervention aussi précoce que possible.

Médecine de premier recours, HUG.
© Victor Santos Rodriguez
Prenons un exemple très concret. La population latino-américaine « sans-papiers » à Genève est en partie constituée de gens qui viennent de Bolivie. Sur le plan géographique, la Bolivie est le pays au monde où la prévalence d’une maladie infectieuse chronique parasitaire qui s’appelle la maladie de Chagas est la plus élevée. Il s’agit d’une maladie qui dure toute la vie et qui, chez 20 à 40% des gens, va créer un problème de cœur, potentiellement mortel. C’est une maladie purement importée (inconnue en Europe parce qu’elle ne s’y transmet pas), vis-à-vis de laquelle la population « sans-papiers » est surreprésentée en termes de risques et de proportion de gens affectés. Ainsi, lorsque notre système de santé s’occupe d’un patient latino-américain et, a fortiori, bolivien, il doit être particulièrement attentif à ces aspects. Il y a donc l’aspect géographique, mais aussi statutaire parce que le « sans-papier » qui n’a pas d’assurance-maladie, pas de permis, va consulter plus tard et le risque est dès lors que la maladie soit plus avancée, plus difficile à traiter. On doit par conséquent créer des dispositifs qui permettent d’intervenir le plus précocement possible pour éviter les complications.
Avez-vous pu constater des dynamiques liées au genre ? Les femmes sans statut légal sont-elles davantage sujettes à certains maux par rapport aux hommes dépourvus de documentation légale, et inversement ?
YJ : Il y a un biais important dans nos observations cliniques, dans la mesure où en termes de priorité d’auto-soins, les femmes attachent plus d’importance à leur santé que les hommes et tendent à consulter plus précocement. C’est probablement un des enjeux principaux en matière de soins et de santé publique.
Pour le groupe de personnes « sans-papiers », la bonne santé est souvent perçue de manière utilitariste, c’est-à-dire que la santé est un outil qui permet de travailler et générer un revenu, ce qui est le principal motif du projet migratoire. La bonne santé n’est pas forcément une valeur en soi, comme dans nos sociétés. Chez nous, la préservation de la santé passe par toute une série de pratiques, y compris de rapidement solliciter des soins lorsque la santé se dégrade. Mon expérience clinique m’a montré que le moment où on va demander des soins est beaucoup plus tardif parmi les « sans-papiers » par rapport à la population en général. En d’autres termes, les « sans-papiers » tirent plus sur la corde que la population en général. De plus, au sein de la population des « sans-papiers », les hommes tirent encore davantage sur la corde que les femmes. Ils consultent nettement moins qu’elles.
Pourquoi ? Il y a certainement de nombreuses explications. Il y a des aspects culturels de genre. Dans la population latino-américaine par exemple, l’homme doit endurer le mal ; se plaindre pourrait être vu comme un aveu de faiblesse. Par ailleurs, il est possible que l’impact fonctionnel de la mauvaise santé soit plus manifeste dans le type d’emploi qu’exercent les femmes. En effet, le marché du travail non déclaré est très genré, les hommes travaillant davantage dans des métiers « physiques » et les femmes dans le care (garde d’enfants, le ménage, etc.). On peut faire l’hypothèse que le type d’activité influence la façon dont les gens demandent des soins.
C’est la première observation : la demande de soins est clairement distincte entre les deux genres. Puis, il y a un deuxième élément : sur le plan démographique, la population « sans-papiers » est une population majoritairement féminine en âge de procréer. Les besoins de santé en matière sexuelle et reproductive sont donc naturellement surreprésentés par le simple fait que la population est majoritairement constituée de femmes qui sont dans leur âge fertile.
Qu’en est-il des enfants « sans-papiers » ?
YJ : Pour la plupart, ils sont assurés dans le cadre de leur scolarité ou avec le soutien d’associations, ce qui veut dire que j’ai peu d’expérience avec eux parce qu’ils n’ont pas de problème d’accès aux soins. Ils vont chez leur pédiatre sans difficulté. Néanmoins, les études qui ont été menées, notamment aux Etats-Unis, nous indiquent que le risque de souffrance psychique est plus élevé. L’exposition à la précarité et l’incertitude en termes de perspective de vie (vais-je rester ? vais-je partir ?) ont un impact sur la santé psychique des enfants. Par ailleurs, comme élément secondaire, la santé psychique altérée a une influence sur la santé dite métabolique, c’est-à-dire qu’on a ici des enfants qui ont plus de risques de développer les maladies chroniques dont on parlait tout à l’heure, par exemple l’obésité.
A plusieurs égards, vous avez déjà anticipé cette question, mais peut-être pourriez-vous compléter : pourquoi, malgré des structures médico-sociales telles que la CAMSCO, gratuites et garantes de confidentialité, la santé des « sans-papiers » demeure-t-elle plus fragile que celle de la population résidente en général ?
YJ : Sur le plan théorique, la santé d’une population n’est que partiellement dépendante du système de santé. Le système de santé, au mieux, joue un rôle qui se chiffre à hauteur de 20 à 25%. Les éléments qui déterminent la santé d’une population sont majoritairement des éléments environnementaux, contextuels, ce qu’on appelle les déterminants sociaux de santé. La CAMSCO n’a aucune influence directe là-dessus. C’est en revanche le cas des politiques publiques. L’opération Papyrus constitue, en ce sens, un laboratoire très intéressant de changement structurel profond d’un des éléments clés, à savoir la légalité et la stabilité du séjour à Genève. Passer de l’illégalité à la légalité a un impact sur toute une série de déterminants sociaux de la santé dont on peut faire l’hypothèse qu’ils vont influer positivement sur la santé des gens.

Le Dr Yves Jackson présente l’étude Parchemins en français, anglais et espagnol en vidéo sur Facebook.
Le constat est le suivant : oui, la population « sans-papiers », considérant son âge (relativement jeune), est en relativement moins bon état de santé que la population résidente légale, sous l’effet de déterminants sociaux de santé délétères (et là je parle de conditions de vie telles que le logement, l’alimentation, les loisirs, la sécurité, la discrimination, etc.), mais aussi d’éléments directement liés au revenu et, troisième domaine, au travail. Les conditions de travail objectives des « sans-papiers » sont en effet mauvaises. Ils font les fameux 3 « D » jobs (dirty, dangerous, degrading).
En plus de votre activité en tant que médecin au contact des populations vulnérables, vous êtes également chercheur en santé publique à travers votre agrégation au sein de la faculté de médecine de l’Université de Genève. C’est avec cette double casquette de praticien et d’universitaire que vous avez lancé le projet de recherche Parchemins, une étude visant à déterminer les effets de la régularisation sur les « sans-papiers ». Pouvez-vous revenir sur la genèse et les principales caractéristiques de l’étude ?
YJ : L’origine de l’étude est très pragmatique. Un jour, début 2017, un patient de ma consultation vient me dire : « docteur, je pense que ma vie va changer parce que je vais postuler pour la régularisation ». Il pose ainsi lui-même la question de recherche : quel est l’impact d’un changement de statut légal sur la santé et les conditions de vie en général ? Je me dis alors que ce n’est pas un médecin seul qui va pouvoir répondre à cette question mais plutôt un ensemble d’experts. Je me tourne donc vers la professeure de sociologie Claudine Burton-Jeangros pour lui proposer de croiser les regards. Assez vite, nous apprenons que dans le cadre de l’opération Papyrus, un mandat d’évaluation a été confié au professeur d’économie Giovanni Ferro-Luzzi. Nous décidons donc tous les trois de rassembler nos forces pour élaborer le projet Parchemins, lequel est distinct du mandat politique qui porte sur le marché du travail. Nous embrassons, quant à nous, une démarche académique plus large, à partir de laquelle nous échafaudons un certain nombre d’hypothèses :
1. La régularisation par l’opération Papyrus peut influencer positivement les déterminants de la santé et du bien-être.
2. L’impact de la régularisation sur la santé et le bien-être sera médié par les changements des conditions de vie.
3. On peut s’attendre à des effets positifs, mais également à des effets délétères. En effet, les gens régularisés font face à de nouveaux défis tels que des charges financières supplémentaires et l’exposition à un monde du travail hyper-compétitif, où il sera difficile de faire valoriser ses acquis et ses compétences. L’accès au travail légal et la possibilité de trouver un poste qui corresponde à ses attentes et ses qualifications risquent d’être assez incertains.
Nous mettons sur pied un dispositif de recherche pluridisciplinaire, employant une méthodologie mixte, qualitative et quantitative, pour appréhender ces phénomènes de la manière la plus globale possible et surtout de façon prospective (c’est-à-dire sur la durée, en observant plusieurs phases dans le changement). De plus, pour mesurer l’effet réel de l’évolution du statut légal, nous décidons d’avoir un groupe de comparaison. Il s’agit de personnes qui ont un vécu commun, c’est-à-dire l’illégalité, la précarité sociale, économique et professionnelle à Genève, mais qui, pour des raisons diverses, n’auront pas la possibilité de bénéficier de la régularisation dans le cadre de l’opération Papyrus. Parchemins est donc une étude comparative, dans le cadre de laquelle il s’agit de mesurer l’impact du statut légal avant et après dans le groupe régularisé et le groupe non régularisé2.
Après avoir bâti l’architecture théorique, nous avons soumis le projet à la Commission cantonale d’éthique de la recherche (CCER) qui nous a donné son feu vert, ce qui est important, dans la mesure où il est ici question d’une population vulnérable. Nous avons par ailleurs pu récolter un soutien large non seulement des acteurs de terrain (les associations partenaires) qui ont été très vite impliqués dans le développement théorique et pratique du projet de recherche, mais aussi des financeurs publics et académiques qui ont vu l’intérêt de pouvoir générer de la connaissance sur un domaine pas du tout étudié. Il y a deux mois, nous avons appris que le Fonds national suisse de la recherche scientifique finance l’étude pour les quatre prochaines années.
Le 6 novembre dernier, vous étiez avec votre équipe à l’Université de Genève pour présenter au grand public vos résultats préliminaires. Quels sont-ils dans le domaine de la santé ? Est-ce que la régularisation des « sans-papiers » influence positivement leur santé et leur niveau de bien-être ?
YJ : Nous ne pouvons pas le dire avec certitude car nous n’avons pas encore le recul nécessaire pour mesurer ces effets. Ce sera l’aspect prospectif – les prochaines vagues de données permettront d’établir des liens de causalité. Pour l’instant, sur la base de la première phase de l’étude visant à récolter des données « baseline » (une photographie au temps zéro nous permettant de voir d’où nous partons), nous pouvons conclure qu’il y a des associations entre des différences de conditions de vie, de santé, de revenu, de conditions de travail ET les différents groupes que nous avons observés3. Il y a un gradient sur quasiment tous les domaines que nous avons étudiés – en termes de santé, de précarité dans les conditions de vie, de difficultés au travail et de revenu. Nous avons par ailleurs essayé de résumer ces dimensions avec des indicateurs de nature plus macro de bien-être et de qualité de vie et, là aussi, il y a un vrai gradient. En d’autres termes : moins le statut est précaire, mieux il semblerait qu’on se porte dans les différents domaines. Encore une fois, il faudra attendre d’entrer dans la phase dynamique de l’étude, mais à ce stade, il est frappant d’observer des différences marquées en matière de santé, de conditions de vie et de situation économique et professionnelle au sein de groupes pas si distants.
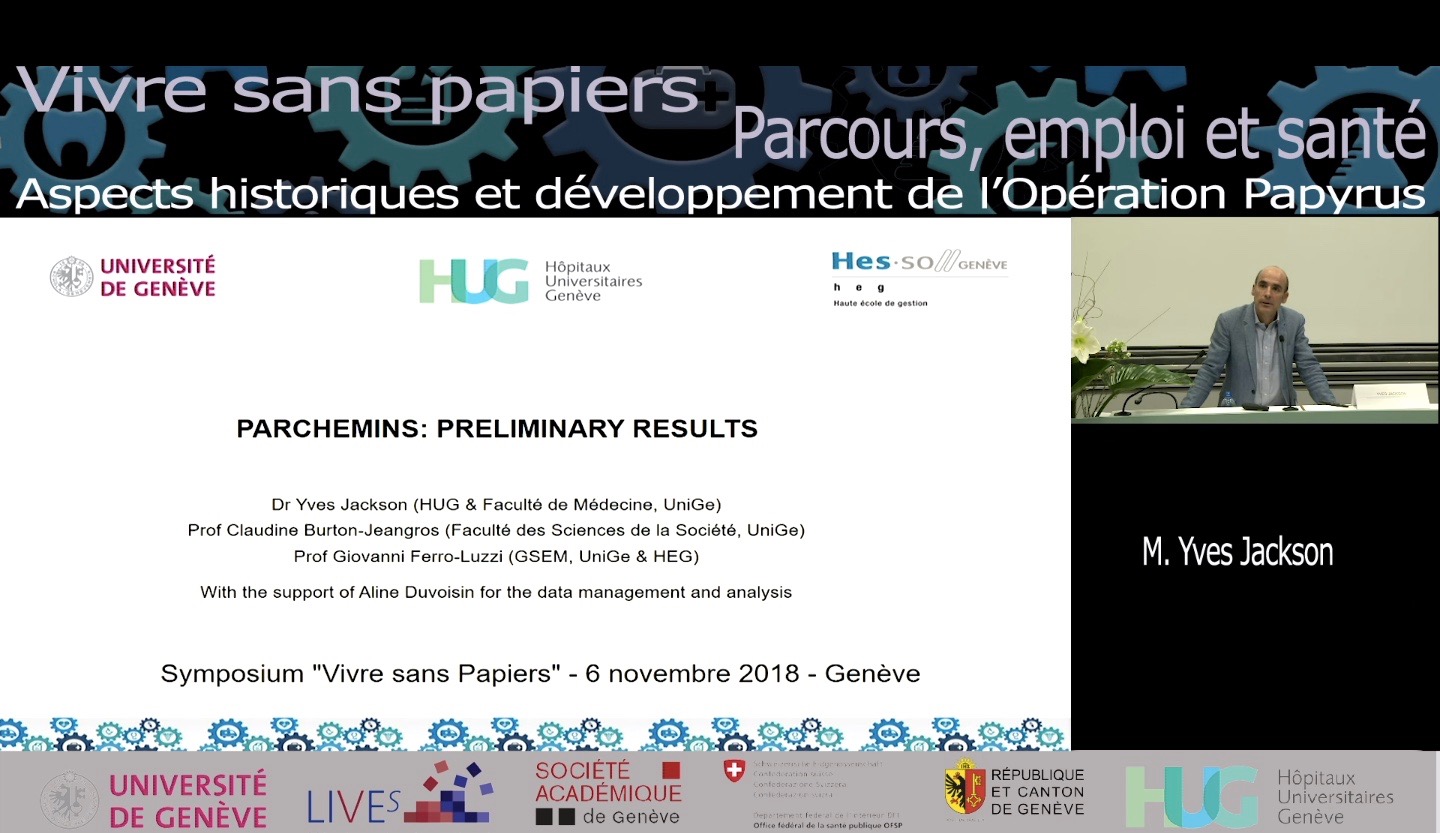
Le Dr Yves Jackson présente les résultats préliminaires de l’étude Parchemins à l’Université de Genève le 6 novembre 2018.
En ce qui concerne la santé, nous pouvons formuler l’hypothèse que l’élément qui diverge le plus est la question de la santé psychique, avec un risque d’être en mauvaise santé psychique qui semble être associé à la précarité matérielle et financière. Rien de nouveau. Mais nous avons été frappés par l’ampleur des différences entre les groupes. Nous ne nous attendions pas à une telle différence en matière de risque de dépression et d’anxiété. A partir de là, nous pouvons formuler une hypothèse, celle de la perspective de vie. Pour des gens sans statut légal, sans perspective de régularisation, on est dans une perspective souvent à très court terme, avec la difficulté de se projeter et de se stabiliser. Par contre, pour les gens qui commencent à entrer dans le processus de régularisation, leur horizon s’approfondit tout à coup. Ils ont la possibilité de faire des projets, d’avoir moins d’inquiétude, plus de sécurité, ce qui agit positivement sur les indicateurs de stress.
Est-ce que les conclusions intermédiaires de votre étude suggèrent des orientations en matière de politiques publiques ?
YJ : Les études qui ont été menées ailleurs et nos résultats préliminaires semblent indiquer que l’amélioration des conditions de vie des groupes de population les plus vulnérables – en l’occurrence ici les « sans-papiers » mais on peut appliquer ceci à d’autres groupes – a un impact majeur sur la santé, sur les capacités à générer un revenu et à utiliser ses capacités dans le milieu professionnel. On peut donc faire l’hypothèse que l’opération Papyrus – ou toute intervention de politique publique qui vise à agir sur les aspects structurels de la précarité et des inégalités sociales – a un impact très clair en matière de santé et sur le plan économique (directement et indirectement parce qu’on facilite ainsi la sortie de la pauvreté extrême, on réduit les coûts à la charge de la société notamment dans le domaine de la santé, les gens étant moins malades, on facilite la participation sociale des personnes, etc.). Les politiques anti-précarité agissent sur un spectre de domaines très large, avec probablement – nos études le montreront à terme – un impact sociétal qui est positif.
Néanmoins, ce que les prochaines vagues de récolte de données vont mieux illustrer, c’est qu’une politique ne peut pas être appliquée isolément. Elle doit être accompagnée d’autres politiques pour réellement maintenir l’impact positif. Je pense notamment ici au marché du travail. Il n’est pas suffisant de permettre l’accès des gens au marché du travail légal si le désavantage lié à la non reconnaissance des qualifications persiste en termes d’accès à l’emploi qualifié. On peut donc faire l’hypothèse que Papyrus devra être complété par d’autres mesures d’accompagnement afin de récolter véritablement tous les bénéfices potentiels de la régularisation des gens.
Notes:
1. Néanmoins, il est intéressant de souligner qu’on parle bien de « transition », ce qui veut dire qu’on n’a pas fait un changement de paradigme épidémiologique. Les maladies infectieuses restent encore présentes dans les pays d’origine.
2. En prenant évidemment conscience des limites puisque ce sont deux groupes qui ne sont pas entièrement comparables, mais qui partagent tout de même un nombre important de caractéristiques communes.
3. Un groupe de gens dit de « contrôle », c’est-à-dire « sans-papiers », en moyenne à Genève depuis huit ans, avec des conditions de vie plutôt défavorables ; un groupe de gens régularisés ou en voie de régularisation que nous avons sous-catégorisés ainsi : des gens qui sont en train de constituer leur dossier administratif pour postuler à la régularisation, des gens qui sont dans le processus, c’est-à-dire qui ont déposé leur demande auprès des autorités compétentes et sont en attente d’une réponse, et des gens qui ont été tout récemment régularisés.




Laisser un commentaire
Soyez le premier à laisser un commentaire